|

|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

|
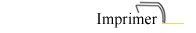
|
Présentation
Sylvie MARTIN
Ãcole normale supérieure Lettres et Sciences humaines, Institut européen Est-Ouest
Étrange idée, de prime abord, que celle d’organiser un colloque autour de deux axes en apparence aussi distants que « La Russie d’Alexandre Ier : réalités, perceptions, mythes » et « Parcours de l’émigration russe (1919-1945) ». Hormis la Russie, quel dénominateur commun trouver à ces deux thématiques ? Un gisement documentaire : « L’événement majeur de ces dernières années est sans conteste le déménagement en 2002 du fonds jésuite de Meudon (bibliothèque slave du père Gagarine et fonds historique du Saint-Georges) à la bibliothèque de l’École normale supérieure Lettres et sciences humaines de Lyon ».1
L’Institut européen Est-Ouest a été créé notamment pour valoriser ce fonds, ainsi que l’ENS LSH s’y est engagée dans une convention signée en juin 2002 avec la Compagnie de Jésus. Aussi a-t-il souhaité donner à son premier colloque un double objectif : refléter, à travers une thématique qui rejoigne les préoccupations de la communauté scientifique, des axes essentiels de « ce fonds internationalement reconnu (plus de 60 000 volumes) »2 et offrir aux chercheurs l’occasion de le découvrir ou de le retrouver dans son nouveau contexte. À cet effet, une présentation du fonds et une exposition de quelques-unes de ses plus belles pièces ont été organisées le 3 décembre 2004 en marge du colloque.
La Russie se réapproprie actuellement la part de sa culture que l’émigration russe a incarnée durant le xxe siècle. De nombreuses publications en témoignent : éditions d’uvres longtemps méconnues, de correspondances, de souvenirs, de témoignages, de documents d’archives. C’est pourquoi l’équipe de la Bibliothèque de l’ENS LSH a commencé le long travail de rétroconversion informatique du catalogue par les collections « émigration » du fonds Saint-Georges, dont l’expertise scientifique fut réalisée au printemps 2004. Il nous a donc semblé intéressant, dans le cadre d’un colloque où étaient réunis chercheurs russes et non-russes, de consacrer deux journées à l’émigration russe de 1919 à 1945 ; la première de ces deux journées était plutôt consacrée aux réseaux et aux lieux de l’émigration, quand la seconde invitait davantage à suivre les itinéraires de figures marquantes. Ce retour sur le passé, où s’entremêlent réappropriation militante (l’expression « Russie hors frontières » est à ce propos révélatrice) et difficulté à assumer un héritage historique encore lourd, s’accompagne souvent d’une charge émotionnelle dont on trouve parfois trace dans certaines communications. Là bat aussi le pouls de la Russie, le signe du temps qui est le brouet de l’historien.
Parallèlement à cette redécouverte d’une culture longtemps bannie, la Russie effectue un réexamen de son histoire. Affranchis désormais du schéma imposé à l’époque soviétique, sensibles aux apports de l’histoire sociale, les chercheurs russes ne pensent plus le xixe siècle avec la révolution d’Octobre pour point de mire.
Avant, sans doute, de resurgir armée d’un autre appareil méthodologique que celui de la période soviétique, l’étude des courants révolutionnaires s’est pour l’instant quelque peu effacée au profit de celle des mouvances « libérales » qui, au long du xixe siècle, ont prôné, sous des formes diverses, la nécessaire évolution du pays vers un régime constitutionnel devant laquelle l’autocratie a toujours regimbé.
De même, la Russie, naguère forteresse assiégée et championne du socialisme dans un seul pays, se penche désormais sur ses échanges politiques, mais aussi culturels avec l’étranger, et notamment l’Europe, pour comprendre comment s’est forgée son identité, au-delà de l’opposition traditionnelle entre slavophiles et occidentalistes. Si l’on date de Pierre le Grand la transformation de la Russie en un État moderne et sa véritable entrée sur la scène européenne, Alexandre Ier fait d’elle le « gendarme de l’Europe » en entrant dans Paris à la tête de ses troupes en 1814. En même temps, les officiers russes, nourris de culture allemande et française, découvrent « sur le terrain » la réalité quotidienne de ces pays dont ils avaient surtout une connaissance livresque. Dans ses contradictions comme dans ses conséquences, le règne d’Alexandre Ier constitue une période féconde pour interroger les échanges Russie-Europe : nous lui avons consacré la première journée de nos travaux. Cela nous a permis en outre de mettre en lumière les collections d’histoire de la « bibliothèque Gagarine », dont l’expertise scientifique avait été effectuée à l’été 2004 pour préparer la rétroconversion du catalogue, en cours aujourd’hui.
On l’aura compris, outre ses objectifs scientifiques, ce premier colloque avait une portée symbolique puissante : transmission, valorisation et continuité fondent l’action de ceux qui ont uvré et uvrent dans le cadre du « fonds jésuite de Meudon ». Aussi le colloque s’est-il ouvert sur une communication consacrée à Ivan Sergeevič Gagarin, fondateur de la Bibliothèque slave. Le Père René Marichal, naguère responsable du Centre d’Études Russes (CER) de Meudon, retrace le cheminement intellectuel et spirituel de ce jeune aristocrate russe né en 1814 qui, converti au catholicisme en 1842, est banni de Russie, entre dans l’Ordre des jésuites pour devenir le Père Jean-Xavier Gagarin. Très tôt convaincu de la vocation européenne de la Russie, il est habité par l’ambition de rapprocher la Russie orthodoxe et le catholicisme occidental. Ce projet est à l’origine de la Bibliothèque slave de Paris et de la revue Études : le père Jean-Xavier Gagarin travaillera toute sa vie à faire connaître la Russie à l’Occident et à étudier les relations de ces deux mondes.
Comme Ivan IV ou Alexandre II, Alexandre Ier compte au nombre de ces souverains russes dont le règne est traditionnellement présenté en deux versants : le premier, commencé sous d’heureux auspices, est porteur de grands espoirs, tandis que la régression opérée durant le second nourrit une cuisante déception. Incarnée par Mihail Speranskij, la première partie du règne d’Alexandre Ier serait lumineuse, alors que la seconde, dominée par Aleksej Arakčeev, retournerait aux ténèbres de la réaction.
Korine Amacher et Marie-Pierre Rey nuancent cette présentation traditionnelle. En analysant la vision que donne d’Alexandre Ier et de son règne l’historiographie russe du xixe et du début du xxe siècle, Korine Amacher montre que l’étude, close sur elle-même, de la psychologie et de la formation d’Alexandre Ier, conçues comme les clés permettant d’expliquer les contradictions de son règne, laisse place à une approche qui met la période en perspective dans l’histoire russe et la replace dans son contexte international. Si la volonté réformatrice n’a pas été véritablement concrétisée, l’opinion éclairée prend place dans la vie publique, ce qui constitue en soi une évolution significative.
Marie-Pierre Rey explore la conception qu’Alexandre Ier a de l’Europe : l’écart est certes important entre le projet initial abstrait et sa mise en uvre à l’épreuve des faits, mais dans le temps même de cet écart et à la faveur des évolutions qui le modulent, la Russie a pris conscience d’être un État européen qui revendique toute sa place comme tel.
Maya Goubina et Éléna Jourdan éclairent la perception croisée qu’ont l’une de l’autre la Russie et la France dans le premier quart du xixe siècle. Les Russes qui séjournent en France sous l’uniforme en 1814 dégrisent l’image idéalisée qu’ils s’étaient forgée de ce pays. Leur découverte de la France « réelle » les conduit à penser que la Russie n’a plus à être regardée en élève ou en mineure du haut de ce phare que serait la France des Lumières ; c’est ce que confirment les écrits de leurs concitoyens civils qui se rendent en France dans les années 1820.
En interrogeant l’image d’Alexandre Ier en France sous la Restauration, Éléna Jourdan éclaire la façon dont se forme l’« opinion » au carrefour entre souvenir, interprétation, mythe et suggestion, au gré des évolutions politiques en cours. Produits de ces reflets croisés, les infléchissements de l’image du tsar russe en disent long sur la France de la Restauration.
Cette subtilité du jeu de miroir, le diplomate Théodose de Lagrené, en poste à Saint-Pétersbourg, la manie avec une grande finesse dans le rapport qu’il consacre à la censure en Russie en 1825. Véra Miltchina montre comment, tout en produisant une analyse précise du fonctionnement de la censure dont il fait de surcroît une sorte de baromètre de la société russe, Lagrené formule « en creux » son avis sur la situation politique française.
En apparence loin des carnets des militaires et des rapports des diplomates, ce sont les journaux féminins dans la Russie du premier quart du xixe siècle qu’explore Éléna Gretchanaïa. Après avoir analysé le rôle essentiel que tient l’espace religieux dans la conception et l’expression du moi des diaristes, Éléna Gretchanaïa prouve que le poète n’a pas toujours raison, fût-il Pukin lui-même : même si le français semble souvent plus familier à ces femmes de la noblesse, elles n’ignorent pas pour autant le russe, se font un plaisir et une fierté de le maîtriser et y recourent dans les passages les plus intensément émotionnels de leurs journaux. Ceux-ci sont donc également un creuset où se forge une identité nationale par le biais d’une identité linguistique.
Un siècle plus tard, les émigrés, surtout les écrivains russes en émigration, feront de la langue le lieu privilégié où se dit l’étrange identité qui est celle de l’exil. Toutefois, quelques figures, si prestigieuses soient-elles, ne doivent pas masquer la forêt que fut l’émigration russe. La « Russie hors frontières » est aussi faite de ce qui compose un corps social : associations, mouvements politiques, Églises, lieux d’échanges intellectuels et artistiques... C’est ce dont nous avons voulu rendre compte, sous la rubrique « lieux et réseaux », durant la première des deux journées consacrées à l’émigration.
Marlène Laruelle met à jour les liens profonds qu’entretient avec la philosophie et la pensée politique européennes l’idéologie eurasiste, nourrie du malaise créé par l’exil chez des intellectuels nationalistes. Ce faisant, elle replace l’eurasisme, qui se revendiquait comme un rejet de l’Occident, au cur de l’histoire intellectuelle de l’Europe.
Pour Il’ja Fondaminskij, dont Nikita Struve retrace la pensée et la vie, l’exil, présent tout au long de l’histoire et de l’action politique russes, est par excellence le lieu où préparer l’avenir de la Russie : car le jour viendra nécessairement où celle-ci s’affranchira de l’emprise qu’exerce sur les esprits le régime bolchevique. Cette profonde conviction fonde l’activité d’éditeur et de penseur de Fondaminskij. Ainsi, il s’inscrit dans la tradition de l’intelligentsia russe, tout comme par la dimension sacrificielle de sa mort, en 1942, dans un camp de concentration allemand où il choisit de « mourir avec les juifs ». Quant à la récente canonisation dont Fondaminskij a fait l’objet en Russie, elle en dit plus long sur une Église orthodoxe russe en mal d’icônes que sur une trajectoire qu’il n’appartient pas au chercheur de juger, mais d’éclairer.
Tatiana Victoroff étudie trois réunions qui eurent lieu au sein du Studio franco-russe où se rencontraient dans les années 1930 écrivains et intellectuels français et russes. Chaque réunion est organisée autour d’un thème : « Orient et Occident », « Symbolisme français et symbolisme russe », « Renouvellement spirituel en France et en Russie ». Au cours d’échanges toujours vifs, le dialogue est souvent difficile et les points de rapprochement restent rares. Toutefois, en dépit des divergences recensées, l’entreprise du Studio franco-russe constitue en elle-même un laboratoire d’une idée européenne que l’on cherche à cerner.
Wim Coudenys étudie le « Bratstvo Russkoj Pravdy », organisation secrète dont l’objectif était la lutte contre le régime bolchevique, à mi-chemin entre mystification et action terroriste. Moins scintillante que celle des grandes figures de la culture, moins gratifiante car elle révèle au grand jour la mesquinerie de nombreux personnages d’un milieu où l’on préférerait ne voir que des martyrs et/ou des héros, l’histoire de ces lieux par définition discrets est pourtant riche d’enseignements : l’héritage qu’ils doivent à la tradition politique russe des « sociétés secrètes », leur portée sur le terrain de l’action, mais aussi sur le théâtre des représentations et des mythes mobilisateurs, les instrumentalisations dont ils ont fait l’objet tant en URSS que dans les pays d’accueil de l’émigration, sont autant de voies fécondes pour la recherche.
Nous remercions particulièrement Lev Mnoukhine d’avoir présenté l’émigration russe à Lyon : pour tout Lyonnais qui lira cet article, l’émigration russe sera désormais incarnée, partie intégrante de l’histoire de la ville, resurgie au détour d’une rue familière ou d’une adresse qui aura cessé d’être impersonnelle. Échantillon convaincant du travail accompli à grande échelle par le Groupe de Recherche sur l’Émigration Russe (GRER)3, l’article de Lev Mnoukhine donne à percevoir la chair d’une communauté dont il restitue la vie dans sa richesse, son quotidien et sa diversité.
En écho à cette tranche de vie qui mentionne combien l’éducation des enfants était une préoccupation majeure de la colonie russe de Lyon, en réponse à Fondaminskij qui prescrit de préparer l’avenir de la Russie en formant dans l’émigration des jeunes capables de pendre la relève du pouvoir bolchevique, Corine Nicolas expose en historienne « les enjeux de la formation » des étudiants russes. À travers l’action du « Comité central de patronage de la jeunesse russe à l’étranger », elle montre combien le soutien aux étudiants russes fut tributaire des conditions économiques des pays d’accueil et du contexte politique international.
Pour clore cette journée consacrée aux lieux et réseaux de l’émigration, Laura Pettinaroli fait écho à l’ambition qui animait le Père Jean-Xavier Gagarin en étudiant la manière dont le catholicisme rencontre l’orthodoxie dans le contexte de l’émigration russe. Si les conflits ne sont pas absents, des enrichissements culturels, intellectuels et spirituels résultent de cette confrontation imposée par l’histoire.
Placée sous le signe des « figures et chemins », la seconde journée consacrée à l’émigration a accordé une place prépondérante aux arts, notamment à la littérature : le texte littéraire est souvent un miroir où l’on trouve des reflets de l’itinéraire de l’auteur, qui nourrit son uvre de sa propre expérience.
Laure Troubetzkoy étudie le traitement du thème de Saint-Pétersbourg dans la prose historique d’Ivan Luka. Ces « histoires pétersbourgeoises », où l’on trouve trace de motifs pouchkiniens et gogoliens, prennent une coloration particulière due à l’exil : pour Luka, Saint-Pétersbourg est à la fois la capitale d’un empire disparu et la ville de son enfance. L’entrelacement de deux évocations, celle d’une histoire impériale balayée par la révolution d’Octobre et celle d’une enfance à jamais enfuie, dont le cadre même n’est accessible à l’émigré que par le souvenir, fait l’originalité du thème pétersbourgeois chez Luka.
Si l’usage conjugué du français et du russe traduisait la manifestation, voire la revendication d’une identité nationale dans les journaux féminins de la Russie du début du xixe siècle, Gayaneh Armaganian-Le Vu montre que le bilinguisme de l’exilé est au contraire le signe même du déracinement, l’expression de l’errance. Pour dire ce drame, Gajto Gazdanov, parfaitement bilingue, invente une langue composite, où se mêlent le russe et l’argot parisien des bas-fonds. Véritable laboratoire littéraire issu de la conscience douloureuse qu’a l’auteur de l’incommunicabilité de l’expérience ressentie, l’écriture de Gazdanov se heurte à la limite qu’elle cherche à dépasser : elle ne peut être réellement lue que par un public restreint, dont l’expérience serait voisine de celle de l’auteur. C’est ce que reconnaît implicitement Gazdanov lui-même en évoquant les modifications opérées sur le texte des Chemins nocturnes (Nočnye dorogi) lors de la publication de cette uvre en volume.
En étudiant la nostalgie (toska) chez Vladimir Nabokov et Marina Cvetaeva, Ludmila Kastler illustre un rapport différent à la langue : la langue maternelle est pour l’émigré le pays natal qu’il emporte dans son exil. Intimement liée à l’enfance, elle est le repère identitaire par excellence, celui qu’aucune propagande, aucun pouvoir politique ne saurait détruire.
Pour les acteurs du Théâtre d’Art de Moscou qui connurent l’exil, la langue, celle de leur pays d’accueil, sera souvent d’abord un obstacle : Marie-Christine Autant-Mathieu retrace les difficultés qu’affronte Marija Germanova lorsqu’elle doit jouer dans une langue étrangère et le refus de Grigorij Hmara d’apprendre le français, ce qui le cantonne à des rôles « exotiques ». Néanmoins, malgré les obstacles et les désillusions, certains membres émigrés du Théâtre d’Art de Moscou parviennent à diffuser à l’étranger les principes du Système de Konstantin Sergeevič Stanislavskij, notamment aux États-Unis.
En analysant le discours de l’émigration russe sur Esenin, Natalia Choubnikova-Gousseva met en lumière les contradictions qui traversent cette dernière. Si la seule vraie Russie et la seule véritable littérature russe sont « hors frontières », comment reconnaître l’uvre d’un « Soviétique » ? L’émigration rejette d’abord Esenin parce qu’il est « soviétique ». Pourtant, elle ne peut durablement ignorer une uvre que certains de ses représentants reconnaissent comme celle d’un grand poète russe. Tristement, c’est le suicide de l’écrivain qui fait soudain de lui un poète authentiquement « national » et une icône : lorsque les critiques soviétiques cessent d’étudier cette personnalité désormais politiquement suspecte, l’émigration lui consacre plusieurs travaux. Il faut attendre les années 1950 pour que les deux littératures russes du xxe siècle (la littérature soviétique et la littérature de l’émigration) s’accordent à voir en lui un grand poète russe.
La lecture de Marcel Proust par l’émigration russe révèle une autre fracture : celle des « pères » et des « fils ». Comme le montre Gervaise Tassis, les écrivains de la première génération, qui se pensent investis de la mission de faire vivre la littérature russe et la conception russe traditionnelle de l’écrivain-citoyen, ne voient souvent en Proust qu’un auteur mondain, adepte de l’esthétisme gratuit. À l’inverse, les écrivains de la deuxième génération, confrontés à la persistance du pouvoir soviétique, tiraillés entre russité et pays d’accueil, saluent en Proust un écrivain de l’introspection, l’inventeur d’une écriture nouvelle. À leurs yeux, Proust marque une rupture dans la création littéraire désormais en quête d’outils propres à dire l’intime, c’est-à-dire pour eux, l’exil.
Danièle Beaune-Gray retrace le parcours de Pavel Muratov, « dilettante aux intuitions fulgurantes » : volontaires ou contraints, ses voyages le mènent de la Russie du Nord à l’Irlande en passant par l’Angleterre, la France, l’Allemagne, l’Italie. Plus que ses théories sur l’art en elles-mêmes, c’est sa volonté de penser l’histoire de l’art dans la perspective d’une idée européenne qui retient l’attention chez celui que Nina Berberova définit comme « un Européen accompli ».
En contrepoint, Véronique Jobert évoque une autre émigration. Géographiquement, tout d’abord, elle quitte l’Europe pour nous entraîner à Kharbin. Ensuite, elle évoque l’itinéraire et les motivations de trois amis, Natalija Il’ina, Oleg Lundstrem et Vitalij Serebrjakov, qui firent le choix de rentrer en URSS en 1947, eurent la chance d’y éviter la déportation et d’y poursuivre leur vie. Installés à Kharbine dans des circonstances diverses, ils n’ont pas le sentiment d’y être véritablement à l’étranger. Ce n’est qu’en 1936, alors que l’occupation japonaise de la Manchourie leur impose de partir pour Shanghai, qu’ils se sentent des émigrés, c’est-à-dire avant tout des déclassés. Dès 1937, sur fond d’intense propagande soviétique, les demandes de rapatriement commencent, mais c’est la guerre puis la victoire de l’URSS qui font définitivement pencher les trois amis en faveur du retour dans leur pays. Le désenchantement subi dès leur arrivée en URSS fait partie intégrante de ces vies dont l’immense mérite est de rappeler, au-delà des jugements péremptoires, toute la complexité des parcours humains.
Anne Hogenhuis le confirme, qui retrace avec une précision minutieuse les cheminements de Boris Vil’de et Anatolij Levickij, fusillés pour faits de résistance par les Allemands le 23 février 1942. Ces deux tempéraments en apparence si divergents entrent de plain-pied dans leur pays d’accueil ; comme le souligne Anne Hogenhuis, l’ethnologie les a certainement aidés à considérer avec distance leur aventure individuelle en la replaçant dans un contexte plus large. Pour autant, ils ne rompent pas avec une « russité », qui nourrit leur vie sentimentale, intellectuelle, publique : Boris Vil’de rejoint ainsi le cercle créé dans la seconde moitié des années 1930 par Fondaminskij. Nikita Struve souligne que ce dernier, contrairement à d’autres, n’émigre pas vers les États-Unis lors de la débâcle française. Levickij et Vil’de ne quittent pas non plus la France vaincue. Comme dans tout choix, des facteurs multiples interviennent vraisemblablement dans celui que font ces trois figures. Anne Hogenhuis suggère qu’il repose sur une certaine conception de l’Homme. C’est certain, mais pourquoi ces hommes qui avaient quitté leur patrie malgré le déchirement de l’exil renoncent-ils à fuir un pays d’accueil quand leur vie est tout autant menacée que naguère ? Peut-être leur conception de l’Homme a-t-elle partie liée avec une certaine idée de l’Europe.
Ce colloque, on le constate en effet, a ouvert de nombreuses pistes et comme l’on pouvait s’y attendre, il y a de l’écho entre les deux sujets choisis, malgré l’apparent paradoxe. Une thématique, sous-jacente ou explicite, revient toutefois comme un fil rouge : l’Europe. Des projets d’Alexandre Ier aux théories sur l’art de Pavel Muratov sur l’art, en passant par les racines intellectuelles de l’idéologie eurasiste et les dialogues difficultueux du Studio franco-russe, l’Europe est toujours présente, en filigrane ou en relief. Aussi l’Institut européen Est-Ouest consacrera-t-il lors des prochaines années une partie de ses travaux à l’idée européenne dans la pensée russe.
Un groupe de recherche en littérature comparée a d’ores et déjà pour problématique l’étude de la littérature de l’émigration russe dans la perspective d’une « écriture européenne »4. Par ailleurs, nous souhaitons également aborder le thème européen sous un angle civilisationniste ; notre objectif sera moins de nous réinscrire dans l’opposition entre occidentalistes et slavophiles en examinant dans quelle mesure l’Europe aura été soit un modèle à rattraper et à dépasser, soit un concept-repoussoir, que d’étudier l’idée européenne dans la pensée politique russe. Nous formons le vu que ces axes de recherche soient le ciment de nouvelles rencontres.
Notes


