|

|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

|
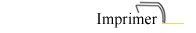
|
L’itinéraire intellectuel de Pavel Muratov (1881-1945)
Danièle BEAUNE-GRAY
Université de Provence
Mots-clés : Russie, émigration, Pavel Muratov, Italie, théorie de l’art
Pavel Muratov, après des études d’ingénierie de haut niveau, apparut dans le monde de l’art et de la littérature tel un dilettante au regard perspicace, aux intuitions fulgurantes, à la culture éclectique, mais quelque peu désordonnée, pour n’avoir connu aucune initiation formelle. Néanmoins, fréquentant peintres et écrivains, il fut confronté aux mutations littéraires et artistiques de son temps, à la réévaluation des valeurs esthétiques et spirituelles aux dépens de l’intérêt social et utilitaire, à la découverte de nouvelles disciplines et au renouveau des anciennes (art russe et byzantin), aux avant-gardes modernistes de toutes couleurs. Des voyages initiatiques, en Italie ou dans la Russie du Nord, au début de sa vie, deux guerres auxquelles il participa activement, deux révolutions, l’émigration en France, à Berlin, en Italie et en Irlande bouleversèrent son existence errante et élargirent son expérience de la vie. Notre propos sera ici de montrer comment ses idées esthétiques se situent face à ces changements et dans quelle mesure elles se transforment en suivant des étapes définies par son apprentissage de l’art ou l’irruption de l’histoire.
Les premiers articles de Muratov sont publiés dans des journaux moscovites lors de la guerre russo-japonaise, en 1905-1906, alors qu’il s’est engagé avec son frère comme volontaire, un an après sa sortie de l’école d’ingénieurs des transports (institution à vocation militaire) et qu’il n’a encore reçu aucune formation littéraire ou artistique autre que celle du lycée. Il dépeint la stratégie des troupes russes, le panache de leur action, passant sous silence les aspects moins glorieux : la perte de moral dans l’armée, les pillages et le maraudage des soldats sur leur chemin de retour par la Sibérie. Boris Zajcev reconnaît que la façon de conter les rend intéressants malgré une idéalisation assez conventionnelle de la guerre et un optimisme qui ne fut pas justifié par les faits. Nous en retiendrons l’idéalisation d’une Russie légitimiste qu’il voulait victorieuse, le goût pour l’Extrême-Orient et l’action militaire, toutes choses qui se tenaient à des lieues des préoccupations des symbolistes ou des décadents.
Moscou à peine retrouvée, l’année 1906 fut pour Muratov un temps de voyages à Londres et à Paris et l’occasion d’une véritable éducation personnelle dont ses articles envoyés à Zori (L’Aube), supplément littéraire de la Pravda, rendent compte.
En Angleterre, il découvre les préraphaélites et se plaît dans leur univers onirique et symbolique. Il est fasciné par ce monde du rêve à mi-chemin entre réalité et fantastique. Il lit Oscar Wilde, dont il avait déjà pu avoir connaissance dans la traduction russe du Portrait de Dorian Gray paru en 1906 aux éditions Grif de Saint-Pétersbourg. Il retient de sa préface l’idée décadente que « les livres ne sont ni moraux, ni immoraux, mais bien ou mal écrits »1. Les vers du poète de Grantchester, Rupert Brooke (source d’inspiration de Vladimir Nabokov en émigration), le ravissent. Il découvre et cite d’abondance Walter H. Pater (1839-1894) professeur de philosophie grecque à Oxford qui, après un voyage déterminant en Italie, s’est consacré à l’interprétation de l’art et de la littérature de la Renaissance italienne et, en particulier, à l’étude de l’uvre de Giorgione. Pater est un esprit éclectique, un théoricien de l’art pour l’art. Affirmant la prédominance de l’esthétique sur l’histoire, s’élevant contre les idées moralisantes de John Ruskin, il faisait de la beauté appréhendée subjectivement l’ultime critère, appliquant sa philosophie du beau à tous les arts, littérature, peinture, sculpture, musique dans une tension vers un art total. Muratov s’imprègne également, dans la lignée de Pater, des idées de Vernon Lee et de Bernard Berenson (citoyen américain d’origine lituanienne) dont il récuse toutefois la méthode de formalisme critique. Ses lectures nourriront ses jugements et le prépareront à l’appréhension de l’art italien.
À Paris, la même année 1906, Muratov visite le Salon d’Automne où Sergej Djagilev exposait des peintres russes contemporains. Il s’éprend des post-impressionnistes français et publie des critiques sur Matisse et Gauguin. Il montre là sa sensibilité à l’évolution de l’esthétique moderne qui se démarque des procédés et du contenu admis et pressent déjà la mort de l’art.
De retour à Moscou, Muratov fréquente les peintres russes qu’il juge les plus séduisants. Il n’a guère de sympathie pour les Ambulants qui peignent des scènes édifiantes pour l’éducation des masses, ni pour Leonid Pasternak qui illustre Voskresenie (Résurrection) de Tolstoj, ni d’ailleurs pour les tendances révolutionnaires des futuristes, fauves et abstraits. Il fraie avec les peintres figuratifs russes marqués par l’impressionnisme ou le post-impressionnisme : Viktor Borisov-Musatov, Nikolaj Krymov, Nikolaj Uljanov, Petr Končalovskij ; il écrit en collaboration avec Boris Grifcov une monographie sur Uljanov qui réunissait dans son atelier de l’Arbat peintres et hommes de lettres et rédige des critiques d’art ainsi que des ouvrages sur Cézanne et Matisse, montrant leur attache à la modernité.
En 1908, Muratov découvre l’Italie avec ravissement, se prend au « piège italien », et séjourne fréquemment entre 1908 et 1911 à Venise, Florence et Rome, en compagnie de sa femme, Urenius, et des Zajcev déjà fervents admirateurs de l’Italie. Les deux hommes entreprennent nombre de projets communs et, en particulier, Zajcev confiera à Muratov le soin de choisir les illustrations de ses livres sur Florence, Sienne, Pise, Fiesole.
C’est le temps où les intellectuels russes se reprennent d’un vif amour pour l’Italie. Florence, terre d’élection de l’humanisme de la Renaissance, est leur seconde patrie, éclipsant Rome et Pompéi qui séduisaient les générations précédentes, Gogol’, le peintre Sergej Ivanov, Karl Brjullov. Mir Iskusstva (Le Monde de l’Art), revue où se rencontraient les symbolistes, décadents et tenants de l’art total d’antan publiait quelques années auparavant les variations sur des thèmes italiens de Dmitrij Merekovskij, Zinajda Gippius, Sergej Volynskij. Ailleurs, on édite les poésies italiennes de Konstantin Bal’mont, Valerij Brjusov, Aleksandr Blok, Anna Ahmatova et surtout de Vjačeslav Ivanov qui, épris de philologie classique, vécut durant de longues années à Florence, ou encore les Impressions d’Italie de Vasilij Rozanov. L’université pétersbourgeoise elle-même se passionnait pour l’Italie et Mihail Bestuev-Rjumin, amassait une documentation importante sur la péninsule tandis que Ivan Grevs, professeur du Moyen Âge latin, dirigeait un séminaire sur Florence et y accompagnait en été ses étudiants.
Mais c’est à Muratov que revient le mérite de cristalliser cet engouement en publiant en 1911 ses Obrazy Italii (Images d’Italie)2, livre marquant dédié à Zajcev « en souvenir des jours heureux ». Cet ouvrage connut un immense succès et le rendit célèbre. Zajcev note combien il s’inscrit dans l’esprit du temps :
La littérature russe ne connaît rien de semblable pour ce qui est de la perception artistique de l’Italie, de l’élégance et du savoir qui ont présidé à la réalisation de ce livre. Ce dernier participe au développement spirituel de notre culture russe qui, dans une renaissance fugace, dans son « siècle d’argent » s’évada du provincialisme de la fin du xixe siècle pour aboutir à l’éclosion tragique et éphémère du début du xxe siècle.3
Les Obrazy Italii tentent de donner une vision globale du génie italien qui se révèle non seulement dans les arts, la peinture et l’architecture mais aussi dans l’histoire, les légendes, la littérature, la musique, les personnages marquants (aussi bien Casanova que les Médicis), le climat d’une ville. Aussi les descriptions précises des tableaux (et le regard de Muratov est d’une acuité confondante), des monuments, d’une rue, alternent avec des récits historiques et littéraires qui délassent des données techniques et débouchent sur une réflexion qui récuse l’intrusion de la morale dans l’évaluation esthétique et qui prend en compte les développements historiques et fait la part belle aux sentiments, au « pèlerinage de l’âme ».
Le subjectivisme revendiqué privilégiera par exemple le Tintoret à Venise, le Quattrocento à Florence (tout en laissant dans l’ombre Fra Angelico), passera rapidement sur la peinture de Giotto, Duccio, Cimabue, au profit de maîtres plus tardifs (Veneziano, Lippi, Masaccio, Pollaiuolo), ignorera le baroque. Il devra même admettre dans la troisième édition de son livre qu’il a méconnu l’influence de Byzance en Italie et reconnaître que Duccio a pu résider à Constantinople, ce qu’il déniait auparavant. Au fil des pages, on peut relever des points qui annoncent déjà le système qu’il mettra en place par la suite : l’importance du mythe et l’inquiétude d’un monde qui en a perdu le sens, une tension vers le classicisme qui ne soit pas imitation, mais création inspirée par des héros, la place respective de l’homme et de la nature dans l’art.
Revenu à Moscou, Muratov se passionne entre 1910 et 1914 pour les activités les plus hétéroclites. Il écrit des articles de critique littéraire, d’autres sur l’art contemporain russe ou occidental, traduit des nouvelles italiennes de la Renaissance, Gérard de Nerval, Prosper Mérimée, ou préface les récits exotiques de William Beckford mis en russe par Zajcev4. Avec Fedor Stepun, il s’intéresse au fondement philosophique du symbolisme. En compagnie du conservateur de musée Trifon Trapeznikov (1882-1926), il assiste aux cours d’anthroposophie de Rudolf Steiner en 1912.
Cependant deux pôles retiennent particulièrement son attention. Tout d’abord, il parfait ses connaissances en art byzantin5 qu’il avait admiré avec quelques réticences à Ravenne ou en Sicile, par la lecture des travaux de Michel-Charles Diehl6 et de Georges Millet7, alors qu’il travaille au musée Rumjancev auprès de Nikolaj Romanov8, conservateur du département d’histoire de l’art et cofondateur du musée des Arts figuratifs à Moscou et met déjà en doute les conclusions de l’archéologue Nikodim Kondakov.
Mais c’est surtout l’étude de l’art russe ancien et de l’icône qui mobilise son énergie. Il déplore l’indifférence des autorités à cet égard. Dans un article paru dans Apollon9, il regrette les goûts néoclassiques des hautes sphères gouvernementales et la création du musée des Arts figuratifs pour abriter des moulages de sculptures étrangères, alors qu’il n’existe pas de musée d’art russe authentique, digne de ce nom :
Nous n’avons pas de musée national où soit réunie de façon honorable notre incomparable peinture d’icônes, où soit exposée la beauté ancienne de l’église russe, du village russe, de la maison marchande russe, de la gentilhommière russe. Le Musée Alexandre III à Saint-Pétersbourg, le Musée historique de Moscou et le Musée de Smolensk de la Princesse Marija Tenieva, sont les composantes séparées d’un tel musée. L’épisode de l’ouverture du Musée des arts figuratifs à Moscou aurait pu être remplacé par le grand événement de la fondation d’un musée national russe.
Car tout un processus de maturation de la reconnaissance de l’art russe ancien était à l’uvre après le long oubli des xviiie et xixe siècles. C’est en effet le moment ou une pléïade de spécialistes de l’icône russe commence à publier. Ce sont Nikolaj čekotov10, Nikolaj Punin11, Andrej Anisimov12 et, surtout, bien sûr, la grande figure d’Igor’ Grabar’13qui réunit autour de lui une constellation de savants afin de collaborer à sa monumentale histoire de l’art.
Cette uvre critique était d’ailleurs le point d’aboutissement d’un travail accompli par les collectionneurs privés et les restaurateurs appartenant à la Vieille Foi. Aussi Muratov fréquente-t-il aussi bien les critiques que les restaurateurs d’icônes, Evgenij Brjagin14, Nikolaj Punin15, Andrej Anisimov. Il explique :
Un seul milieu garda un amour fort pour l’icône ancienne authentique : c’est celui des Vieux-Croyants. Là se déroula sans interruption, de génération en génération, le fil de la vénération et du sens de la tradition. Et si l’icône ancienne fut ressuscitée au début de ce siècle, nous en sommes redevables avant tout et plus que tout aux Vieux-Croyants russes. Pour des considérations non pas artistiques, bien entendu, mais religieuses, de murs, de rites, les Vieux-Croyants apprirent à discerner, prendre soin et même à débarrasser l’icône ancienne des altérations ultérieures. Ils n’avaient pas d’églises à leur disposition, celles-ci se trouvaient dans les mains de l’Église dominante. Ils construisaient leurs monastères dans les forêts profondes, leurs temples secrets dans les villes et les villages. Ils initièrent la collection d’icônes anciennes ; les premiers collectionneurs russes sortirent de leurs rangs.16
Sensible à l’appel du russkij sever (« nord russe ») - thébaïde du grand Nord russe, pays des monastères bâtis au bord de lacs transparents, refuge des Vieux-Croyants et gardien des traditions ancestrales - Muratov voyage en particulier dans la région de Vologda, sur le lac Kuban ; il rend visite au monastère de Saint-Cyrille-du-Lac-Blanc, forteresse grandiose et inexpugnable et à Théraponte, délicate chartreuse en miniature, qui reçoit tous ses suffrages. Il place au faîte de l’art russe les fresques peintes par Denys sur les murs de la cathédrale de l’Assomption à Théraponte pour leur caractère russe achevé, la préciosité des tons pastels habilement contrastés (bleu ciel, ocre et rouge foncé), leur savante composition qui témoigne d’un art mûr et élaboré et l’utilisation de la lumière qui éclaire chaque heure d’un jour nouveau.
Il collabore à la première grande exposition d’icônes anciennes choisies parmi les collections de Pavel Rjabuinskij et Evgraf Tjulin qui s’ouvre à Moscou au début de 1913, compose le catalogue et écrit un article d’introduction dans lequel il tente d’esquisser les grandes lignes de l’évolution de l’icône et de classer les uvres par période en les mettant en parallèle avec celles des époques correspondantes de la peinture byzantine17. Mais son goût pour l’analyse se révèle davantage dans une étude de la collection iconographique d’Ostruhov ou dans le tome consacré à l’art de la Russie ancienne que Grabar’ lui a confié dans le cadre d’une édition monumentale de l’histoire de l’art. Là, il se montre novateur car c’est la première histoire des icônes et fresques russes fondée sur la méthodologie de la recherche occidentale (Berenson, Heinrich Wölfflin), analysant l’apport de la tradition byzantine et l’originalité du style russe et mettant en avant des critères plus esthétiques que chronologiques et s’opposant ainsi à la Commission archéologique qui jusqu’à la révolution était chargée de la conservation du patrimoine et donc des icônes. Composée d’archéologues éminents celle-ci était plus préoccupée de datation que de stylistique, d’esthétique ou de contenu religieux. Subventionnée par le gouvernement, elle suscitait le ressentiment des nouvelles vocations.
En 1914, à la veille de la première guerre mondiale, Muratov entreprend une carrière d’écrivain et publie des récits marqués par la prose transparente et classique de Mérimée, Anatole France, Henri de Régnier. Toutefois, c’est surtout en tant qu’historien de l’art qu’il est reconnu. Avec son ami éditeur Konstantin Nekrasov (neveu de l’écrivain) et grâce au mécénat de Jaroslav Karzinkin, un riche marchand, il édite une revue Sofija (Sophie), qui publie entre janvier et juin 1914 six numéros comprenant des articles sur l’art, la théosophie et la littérature. Dans la grande richesse de ces publications nous ne signalerons que les articles exemplaires de Nikolaj Berdjaev sur Picasso et de Mihail Gerenson sur Pukin. La revue, par son éclectisme, ressemble à Apollon, mais s’en distingue par l’accent mis sur la littérature et l’art anciens (en particulier de l’Antiquité ou de la Russie du Moyen Âge) et sur la pérennité classique que défend Muratov :
Il est une opinion selon laquelle l’art ne peut être l’objet d’aucune appréciation stable, d’aucune affirmation qui pourrait être prise pour une vérité permanente. Tout passe, tout change, tout devient ennuyeux après un temps : les goûts, les points de vue, les enthousiasmes, les antipathies. Tout ce qui plaisait hier, ne plaira pas demain et inversement. Nous devons être éternellement prêts à des réévaluations et les hommes qui entendent l’art savent les deviner et sont, au sens littéral, des hommes d’avant-garde clairvoyants. Or, il convient de lutter par tous les moyens contre cette maladie de la critique, car elle porte en elle la perversion des esprits. Tout le travail sérieux et consciencieux des critiques d’art occidentaux tend aujourd’hui à limiter le cercle des tâtonnements et des réévaluations à la sphère des prédilections personnelles. Dans les écrits russes sur l’art, la notion d’un travail critique créateur de cette sorte est absente. Notre critique est toujours à la recherche d’une voie indiquée par la boussole de la mode idéologique, rêve toujours de réévaluations, martèle constamment sa devise : ce qui plaît aujourd’hui ne plaira pas demain.18
La guerre met fin pour un temps à sa vie d’esthète. Il est appelé en tant qu’officier d’artillerie sur le front autrichien. Il fait partie de ces rares intellectuels russes qui combattirent en première ligne et il garda un souvenir effroyable de l’inhumanité de la tuerie. Le côté sordide de la guerre de tranchées, la mécanisation des moyens mis en uvre grâce à l’industrialisation, ont ôté tout panache à la vie militaire et ne lui ont laissé que son aspect ignoble.
Au moment de la révolution, il se trouve à Sébastopol et revient à Moscou en mars 1918. Bien que n’éprouvant aucune sympathie pour la révolution, il participe activement aux multiples commissions chargées, sous l’égide des égéries du pouvoir (la compagne d’Anatolij Lunačarskij et celle de Trockij), de la conservation du patrimoine. Aux côtés de Igor’ Grabar’, Nikolaj Romanov, Andrej Efros, Andrej Čajanov, il est élu lors du Congrès coopératif pan-russe au præsidium du Comité pour la conservation du patrimoine artistique et scientifique. Ce comité et ceux qui suivront suscitent bien des espoirs parmi les historiens de l’art. À la différence de la ci-devant commission archéologique, il laissait le champ libre aux interprétations esthétiques et religieuses de l’art russe, s’entourait de restaurateurs expérimentés, et n’avait plus à craindre la méfiance des ecclésiastiques en charge des églises, cathédrales ou monastères qui n’avaient pas toujours un goût très formé en matière de restauration et se contentaient parfois de barbouillages approximatifs. Il comptait en outre sur des moyens importants pour préserver les trésors authentiques et oubliés de la province russe alors que les sommes autrefois allouées à la commission archéologique servaient à patronner des uvres de prestige dans les capitales, des constructions grandioses de style néo-russe, le Sauveur-sur-le-Sang à Saint-Pétersbourg, le Musée historique à Moscou. Certes, Grabar’ put, grâce à ces nouvelles institutions, procéder à un certain nombre d’inventaires et de restaurations à Vladimir, Novgorod et Pskov. Mais Muratov dut vite déchanter : les nouvelles qui parvenaient des saccages des monastères autour du Lac Blanc montraient à quel point ces espoirs étaient vains. Une poignée de savants isolés sur des sites éloignés, ne pouvaient en aucune manière faire pièce à la populace déchaînée et manipulée par les Sans-Dieu qui s’employaient à piller églises et monastères, sans parler de l’assassinat des prêtres, moines et moniales. Enfin la protection des grandes dames proches du pouvoir s’avéra fragile...
Muratov publie dans la presse antibolchevique qui survit encore pendant l’année 1918, en particulier dans Ponedel’nik (Lundi) et Narodnye Slova (Paroles populaires). Il fréquente toujours Zajcev et, pour oublier la réalité menaçante, ils se lancent tous deux dans des activités littéraires multiples. À la Librairie des Écrivains (Lavka pisatelej), ils organisent un studio italiano (qui s’oppose au Palais des Arts (Dvorec iskusstv)de tendance pro-bolchevique) dont Muratov est président. Ses collaborateurs sont de vieux amis, Aleksej Divelegov, Boris Grivcov, Ivan Novikov, Mihail Osorgin. Il organise des conférences sur Raphaël, Dante, Venise. Le 7 mai 1921, Blok y lit ses vers sur l’Italie. Muratov, quant à lui, traduit les quatre tomes de Berenson sur la peinture de la Renaissance italienne dont seul le volume sur les peintres florentins verra le jour. Son travail consiste davantage à conserver ce qui est en péril, réservant son esprit d’invention à la création littéraire qui est également pour lui un moyen de s’évader d’une réalité porteuse d’angoisse. Récits magiques (Magičeskie rasskazy), Héros et héroïnes (Geroi i geroini) reflètent une face cachée de son tempérament marquée par la théosophie et l’attrait qu’exercent sur lui les religions orientales et, en particulier, l’hindouisme de Ghandi.
Bien que n’ayant aucun goût pour l’action contre-révolutionnaire, Muratov se situe nettement dans le camp anticommuniste. Il abhorre l’atmosphère soviétique en particulier à cause de sa mouvance, de son instabilité. Il rejoint donc une sorte d’émigration intérieure et se préoccupe davantage de conserver, de transmettre. Il retrouve un peu de sa joie de vivre au moment de la NEP19. Mais un soir alors qu’il rejoignait le Comité d’aide aux affamés auquel il adhère depuis 1921 et bien qu’il ait été prévenu d’une arrestation imminente, il partage volontairement le sort de ses camarades, en particulier de Zajcev, et est emmené à la Lubjanka. En raison de sa formation militaire, Muratov est l’âme de la chambrée où il organise des exposés sur la littérature et les icônes. L’historien Robert Vipper, qui les rejoint bientôt, parle de ses dernières recherches. Grâce à l’intervention du Président Wilson, les membres du Comité d’aide aux affamés sont libérés puis expulsés d’URSS en mai 1922 avec tout un groupe d’intellectuels.
À leur arrivée en Occident, les Muratov séjournent d’abord à Berlin qui était encore le foyer le plus important de l’émigration et passent l’été 1923 en villégiature en compagnie de Boris Zajcev, Nikolaj Berdjaev, Mihail Osorgin, Vladislav Hodasevič et Nina Berberova qui lui voue une grande admiration :
Muratov était un homme calme, réfléchi, capable de comprendre les souffrances des autres. C’est lui qui avait fait connaître l’Italie aux Symbolistes russes. Il était à sa manière un Symboliste avec son culte de l’Éternel féminin ; il ne ressemblait cependant à aucun d’eux. Son symbolisme n’était ni brumeux, ni décadent, mais transparent et classique. Il était toujours amoureux, mais son amour, triste ou joyeux, était lui aussi légèrement stylisé. Ses enchantements et ses désillusions étaient de nature plus intellectuelle, quoiqu’il ne manquât pas de sensualité. Il semait à tout vent ses pensées originales qu’un autre à sa place aurait gardées jalousement. Certaines d’entre elles vivent encore aujourd’hui en moi. Il ne cherchait pas à être reconnu, il aimait par-dessus tout la liberté. C’était un Européen accompli. Il avait découvert l’Europe avant la première guerre mondiale et je l’ai découverte à mon tour, cette année-là à travers lui. C’est en sa compagnie que j’ai entendu pour la première fois les noms de Gide, Proust, Valéry, Virginia Woolf, Papini, Spengler, Mann et de bien d’autres qui lui étaient familiers et qui nourrissaient sa pensée dépourvue des préjugés de sa génération. Il venait souvent chez nous. Il aimait me voir coudre sous la lampe et il l’évoque dans la nouvelle Schéhérazade qu’il m’a dédiée.20
Muratov a donc retrouvé à Berlin une grande partie de ses amis. Berberova note que « les Moscovites, Osorgin, les Zajcev, Muratov, Berdjaev, Stepun restent entre eux21 ». Il fréquente les cabarets berlinois, courtise Berberova et fonde le Club des Écrivains. Il participe aux multiples activités que les émigrés organisent en exil alors que Berlin est pour quelques temps encore la capitale de l’émigration russe avant de céder la place à Paris dans les années 1925. Il donne des conférences à l’Institut scientifique russe, publie des articles dans la revue berlinoise Beseda (Conversation) et l’hebdomadaire de Prague Volja Rossii (La Liberté de la Russie) et s’oppose comme auparavant au byzantiniste russe émigré à Prague, Kondakov, auquel il reproche son appréciation chronologique aux dépens d’une analyse esthétique. L’éditeur Zinovij Grebin prépare l’édition complète des Obrazy Italii22.
Cependant, comme maints compagnons d’exil, il ne tient pas en place. Il part pour Rome où il écrit sur l’histoire de l’art et sert de guide à ses visiteurs Hodasevič et Berberova :
Cela me paraît maintenant fantastique d’avoir visité Rome avec un pareil guide ; c’était comme un rêve étourdissant. Je me revois debout près du Moïse de Michel-Ange, avec à côté de moi cet homme petit et silencieux. Il était avec nous lors de notre longue promenade à travers le Transtévère ; nous nous arrêtions dans les courettes anciennes qu’il connaissait comme s’il y était né. Nous regardions un bas-relief anonyme aussi attentivement que s’il s’agissait des fresques de Raphaël. Nous flânions le long de la voie Appia parmi les tombes. Le soir, nous nous attardions au café près de la Piazza Navona et dînions dans un restaurant non loin de la Trévi... Nous nous intéressions aussi à l’Italie contemporaine.23
À Rome, les Muratov qui vivent près de la Piazza del Popolo, fréquentent Vjačeslav Ivanov, l’architecte russe Georgij Čiltian et la fine fleur de l’intelligentsia italienne.
En émigration, Muratov complète et infléchit ses jugements sur l’art. Il donne désormais toute sa dimension à la peinture de Giotto, Cimabue et Duccio car, dans un ouvrage écrit en français, L’Ancienne peinture russe24, sa réflexion sur l’icône russe le convainc que sa parenté avec les primitifs italiens remonte à une origine byzantine commune ; il remet en perspective les fresques de Fra Angelico, en particulier celles de San Marco, qu’il avait laissées dans l’ombre dans son ouvrage capital et écrit un livre sur le sujet25 qui est jusqu’à aujourd’hui cité dans les publications scientifiques. Il rend dès lors hommage au baroque italien et au Seicento qu’il avait méconnu. Point de bouleversement donc dans ses appréciations, mais plutôt enrichissement et maturation.
Cependant l’exil et le déracinement, l’éloignement géographique de l’art russe, le défi de l’art moderne qui s’affirme chaque jour davantage, le conduisent, plus qu’à l’analyse, à un travail de synthèse et de systématisation de toutes les connaissances accumulées dans la fièvre de la découverte du néophyte.
Dans les ouvrages qu’il rédige alors, mais surtout dans une série d’articles remarquables composés entre 1923 et 1927 et publiés par Sovremennye zapiski (Les Annales contemporaines), la revue d’Aleksandr Kerenskij éditée à Paris, alors que l’émigration (et Gippius en particulier sous le pseudonyme d’Anton Krajnij) lançait une polémique sur l’existence même de la littérature émigrée au moment où la jeune génération moderne (Berberova, Nabokov, Poplavskij et d’autres) tentait de s’imposer, il s’interroge sur la nature de l’art moderne russe et européen. Et tandis que Gippius attribuait à la révolution et l’exil l’impossibilité d’une nouvelle littérature russe, Muratov invoque la mort de l’art européen : la transformation progressive de la civilisation européenne a tué l’art qui fait place à l’anti-art dans une post-Europe. Sa démonstration s’appuie sur une théorie de l’évolution de l’art dont il propose un découpage personnel.
Dans une première période qu’il nomme hellénistique ou pré-européenne, il englobe des domaines aussi vastes et divers que l’Antiquité, le Moyen Âge, le Trecento, le Quattrocento, Giotto, Botticelli, Raphaël, la France gothique, la Renaissance, la peinture byzantine, l’icône et la fresque russes, excluant toutefois l’Orient islamique ou païen. L’homme, transcendé par le mythe hellène ou chrétien, est alors le sujet central de l’art, qu’il s’agisse de la peinture de portrait, la sculpture grecque, l’anthropocentrisme des fresques et des icônes byzantines ou russes qui ne connaissent que des paysages rudimentaires. Le point d’orgue de cette période est l’aboutissement d’un idéal classique exprimé dans les fresques de Saint-Théraponte :
Les fresques de Saint-Théraponte nous surprennent par la perfection de leur style. L’équilibre définitif qu’on y voit atteint par l’art révèle l’apogée classique. Les mouvements y sont exprimés avec une parcimonie pleine de réserve. Le même sens de la mesure se retrouve dans tous les détails caractéristiques. Cette pondération dans le sentiment est le signe auquel on reconnaît la phase classique. C’est à peine si Saint Jean l’Évangéliste, dont maintes icônes novgorodiennes aiment à faire une figure des plus dramatiques, esquisse ici un léger mouvement de l’avant-corps. Le rythme des compositions à plusieurs personnages se résout en la grâce affinée et alanguie d’un geste unique. L’ascétisme de Saint Jean-Baptiste et la sévérité de Nicolas le Thaumaturge sont adoucis comme rarement ils le furent avant et après Denys.26
Cependant la crise de la conscience européenne du xviie siècle engendre un nouveau regard de l’artiste, une nouvelle période artistique, l’époque européenne :
La figure humaine cesse d’être le motif central de l’art. Apparaît un sentiment « choral » de la nature. C’est le règne de la poésie et de la prose de la nature en littérature, de la nature morte et du paysage dans l’art pictural. La peinture se fonde sur la tonalité, la lumière, les valeurs. Il y a là rupture avec l’anthropomorphisme pré-européen hellénistique. L’Européen ne cherche plus en son cur, mais dans le monde exogène, les normes de son éthique et de sa conduite. Il part à la recherche de son âme dans l’apparence de l’univers et c’est pour cela qu’il donne tant d’importance à la lumière qui la révèle et que prend corps la « révolution luministe ».27
Mais cette peinture sera attaquée de l’intérieur. Après le classicisme vint le baroque qui laisse entrevoir au milieu de sa splendeur une fêlure, l’isolement de l’artiste qui n’est perceptible qu’à l’il averti :
Jusqu’à aujourd’hui, le côté officiel de l’art baroque, (les fresques, les temples fastueux de la Contre-Réforme) le décor des salles d’apparat qui abritaient des us et coutumes trop solennelles a trompé notre regard. Nous voyons partout le génie du Bernin théâtral et magnifiquement illusoire [...]. Dans le tumulte de cette époque bruyante, nous ne distinguions plus la voix humaine [...] contemporaine, isolée, solitaire. Quelque chose s’est soudain cassé dans le psychisme humain et l’art perdit d’un coup le calme olympien du Cinquecento. Non, le Seicento n’a pas produit que des tempéraments forts qui surchargent les places de décorations, de fontaines, de jardins, de scènes de théâtre et de cérémonies ecclésiastiques. Tous ses peintres n’étaient pas hommes à promener leur pinceau facile sur des kilomètres de surfaces murales et plafonnières « a la presto ». Le baroque fut semé d’autres graines qui levèrent au xviiie et au xixe siècles dans le romantisme, la Révolution, le désenchantement et la nostalgie, dans la solitude de l’artiste, dans la dissonance avec son temps et l’hostilité de la société.28
Cette cassure pousse l’artiste sur des chemins de traverse à la recherche des moyens d’expression qui n’appartiennent plus à la sphère artistique. Les impressionnistes dans leur culte de la lumière en viennent à prôner une approche scientifique de l’éclairage et se livrent à une analyse spectrale de la lumière. Mais la décomposition scientifique de celle-ci aboutit à la dilution de la forme picturale traditionnelle. La forme disparaît et il ne reste plus que des taches de couleur (Monet, Pissaro). L’artiste est alors victime d’un double malentendu : il se sert de moyens qui n’appartiennent pas à l’art, mais aux sciences exactes et en acquérant une liberté totale, n’étant plus tenu par le thème, il ne communique plus avec ses contemporains. Cézanne est le dernier artiste qui, pressentant le péril, essaie de revenir à une forme stable en retournant au réalisme du dessin.
Après Cézanne commence la troisième période que Muratov appelle post-européenne (cubisme, constructivisme, art abstrait, mobiles, machinisme, dynamisme, etc.) au cours de laquelle l’artiste se retranche de la société. En effet, auparavant, et en particulier dans la période pré-européenne, l’artiste participait à la vie du peuple, lui était indispensable. Il n’existait pas de frontière nette entre l’artisan et l’artiste, entre le ferronnier, le menuisier et le peintre. Mais ce lien se perd au cours de la période européenne. Au xxe siècle, l’artiste est devenu un professionnel isolé, coupé des autres classes de la société.
De surcroît, l’industrialisation (ou, mieux dit, l’industrialisme), la mécanisation de la société, le mépris de la nature que l’homme prétend dompter, le rythme inhumain de l’existence, rendent l’uvre artistique étrangère à la vie contemporaine. Elle n’a plus sa place dans une demeure, mais s’expose dans un musée qui n’est qu’une antichambre de la mort. L’artiste ressent donc l’angoisse d’un monde à l’agonie, et pour résister à la pulsion de mort, il se projette dans des expériences novatrices qui ont toutes en commun le désir de surmonter la tradition de la peinture tonale évanescente et d’entrer dans le monde de la post-Europe. Il se lance dans un retour artificiel à la peinture pré-européenne, gothique, byzantine ou primitive. Cependant, les essais des peintres russes modernes - Kuz’ma Petrov-Vodkin (1871-1939), Natalija Gončarova (1881-1962) - de créer une nouvelle tradition n’ont pas réussi. De même les recherches orientalistes ou africaines n’ont pas dépassé le stade du simple intérêt pour l’exotisme. C’est plutôt dans la poursuite d’une nouvelle perception de l’époque, utilisant sa mécanique, sa dynamique, que les peintres ont fait école. Mais ce pseudo-art déshumanisé, en accord avec la post-Europe mécanique, électrique et machiniste, n’a plus rien de commun avec l’art, car il fait fi de l’homme et de son aspiration à la transcendance ; il ne communique plus avec la vie populaire, il construit des quartiers entiers sans architecture dans les faubourgs de Berlin, Paris et Rome. Ce ne sont que des projets d’ingénieurs, gages d’émeutes et de destruction pour l’avenir.
L’art hellénistique tournait l’attention vers l’âme, l’art européen donnait accès à une énergie humaine supérieure, mais l’homme en se rendant maître de la nature et en luttant contre elle est devenu l’esclave des forces mécaniques et a donné naissance à l’anti-art qui provoque une rupture de la conscience. C’est une idole dont la victoire signifiera l’asservissement de l’humanité et le règne de l’apocalypse.
Le pessimisme de Muratov serait proche de celui d’un Konstantin Leontjev, s’il ne conservait, en dépit de l’expérience de la révolution et de l’exil une foi indestructible dans les forces populaires. En effet, notre auteur perçoit dans la soif de récréation des peuples européens les prémisses d’un sabbat et d’un retour vers l’art dans un élan de libre création.
La synthèse muratovienne ne manque pas de séduction pour l’esprit contemporain qui a vu se réaliser certaines de ses prémonitions. Ses conclusions sont en tout cas fécondes pour ce qui est du passage de l’art figuratif à l’art abstrait. Toutefois, son passéisme qui récuse toute tentative novatrice, son esprit de système qui écarte sans argumenter tout ce qui le contredit, son absence de pratique du métier et de ses contingences, en particulier du passage de la détrempe à la peinture à l’huile, ses intuitions qui ne se fondent pas sur une expérience incontestable en limitent la portée.
Après cette série de brillants articles, Muratov quitte les Sovremennye zapiski pour rejoindre Vozrodenie (La Renaissance) qui assume une attitude esthétique et politique plus réactionnaire, après le départ de Petr Struve pour Prague et la reprise en mains de la publication par un industriel connu Abram Gukasov, antibolchevique notoire. Il assume donc des positions toujours plus conservatrices. Berberova note :
Aldanov et Tsetline trouvaient que Mouratov était devenu réactionnaire et qu’il était passé dans le camp des antidémocrates, surtout à la suite de son article intitulé Grands-mères et grands-pères de la Révolution russe, dans lequel il traitait de prédateurs les « meilleurs représentants de l’ancien radicalisme russe.29
En effet, au fur et à mesure que le bolchevisme s’installe dans la durée en Russie, et au moment de la montée de Hitler en Allemagne, l’émigration prend des positions plus tranchées et intolérantes se divisant toujours davantage. Muratov se trouve très isolé à Paris et prend le parti de voyager, sans doute aussi pour rendre visite à des groupes politiques qui l’intéressaient à l’étranger. On le trouve au Japon, aux États-Unis, puis il se réinstalle à Paris où il rédige une histoire de la guerre russo-allemande de 1914, revenant ainsi à ses premières amours, l’histoire militaire dont il fut le témoin engagé.
Au moment de la seconde guerre mondiale, il séjourne en Angleterre puis se réfugie chez un ami en Irlande. Il se prend de passion pour le jardinage et la botanique comme les hobereaux russes d’antan et travaille à un nouveau livre sur les relations russo-britanniques au xvie siècle, mais il meurt sans l’avoir terminé le 5 octobre1950.
Nous avons pu constater au cours de cet exposé que l’itinéraire de Muratov était plus conforme à un héritage livresque stimulant (Pater, Berenson) qu’à la mode ambiante et que sa réflexion le conduisait toujours à un certain recul, ou parfois une certaine avance, par rapport à ses contemporains. C’est ainsi que tout en se reconnaissant dans le siècle d’argent, dans sa mise au premier plan des valeurs esthétiques au préjudice de la morale, il en répudiait l’instabilité et croyait à la pérennité de l’art. À mesure que sa culture s’enrichissait, son jugement certes s’infléchissait, et il réajustait ses hiérarchies. Revenant sur des points importants comme son appréciation tardive du baroque italien et une réévaluation des primitifs, il n’opère peu ou pas de changement radical de ses opinions, maintenant le choix d’un classicisme pérenne. Et, écrivant à plusieurs années de distance sur l’art byzantin ou l’icône russe, il souligne combien le temps a confirmé ses hypothèses.
Le choc de la révolution et de l’exil l’ont conduit à un retour sur soi-même, au besoin de se situer dans la société qui pour lui est le monde de l’art européen (Russie comprise), à y définir sa place qui est celle d’un conservateur raisonné et éclairé et à en proposer une synthèse. À l’instar de Georgij Fedotov, ou de Il’ja Fondaminskij qui tentaient de mettre au jour dans un livre somme les racines de la catastrophe et de la rupture révolutionnaires qui les avaient privés de leur patrie, Muratov cherche à cerner les causes spirituelles - spirituelles et non morales - du délitement de l’art russe et européen. L’émigration, commencée en territoire bolchevique, le prive certes de certains de ses outils de travail : collections et architecture russes, bibliothèques spécialisées, environnement scientifique varié, fondé sur une culture russe, mais ne bouleverse pas sa vision du monde, elle la cristallise et lui permet de rédiger une synthèse brillante de ses idées. Puis ayant épuisé son sujet, dans une terre étrangère qui n’a guère besoin des intuitions étincelantes d’un dilettante russe, il revient dans les dernières années de sa vie à son point de départ, l’histoire militaire. Enfin, coupé du monde dans un domaine irlandais alors que la guerre fait rage dans les pays voisins, il se réfugie dans un passé plus lointain, tentant chaque fois par l’étude de relations bilatérales de montrer la place de la Russie en Europe.
Notes


