|

|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

|
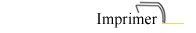
|
Lectures de Marcel Proust dans l’émigration
de l’entre-deux-guerres
Gervaise TASSIS
Université de Genève, Département des langues méditerranéennes, slaves et orientales, Unité de langue, littérature et civilisation russes
Plan de l’article
Mots-clés : émigration, littérature, réception, Marcel Proust, Jurij Fel’zen
Si quelques écrivains émigrés russes s’installent à Paris dès 1919, ce n’est qu’en 1924 que la capitale française devient également la capitale culturelle de l’émigration russe, après une première époque de la littérature émigrée appelée berlinoise et marquée par la coexistence, dans la capitale allemande, d’écrivains émigrés et soviétiques. C’est pourtant à Paris que, dès 1920, d’anciens hommes politiques fondent la revue Sovremennye zapiski (Les Annales contemporaines), dont les 70 numéros sont d’une importance capitale pour la littérature de l’émigration, et le quotidien Poslednie novosti (Les Dernières nouvelles), lesquels ne cesseront de paraître qu’en 1940, avec l’invasion allemande. Les Sovremennye zapiski avaient d’ailleurs pris le relais de Grjadučaja Rossija (La Russie future), fondée, en 1920, également à Paris, par Aleksej Tolstoj, Mark Aldanov et Victor Henri.
Les écrivains qui avaient choisi l’exil par opposition au régime bolchevique mis en place dans la terreur se voulaient les garants, les conservateurs de l’esprit de la grande littérature russe, qui ne pouvait se développer dans la métropole à cause de l’oppression. Ils avaient donc pour mission de favoriser la poursuite du développement de la littérature russe, et notamment de la protéger tant de l’influence soviétique que des influences européennes. Il s’agissait de se démarquer tant de la littérature de la métropole, tombée sous la coupe du Parti dès 1925, que de la littérature moderne européenne, pour mieux conserver l’esprit de la littérature russe, et continuer à créer dans sa tradition. Toutefois, les écrivains émigrés vivant dans un milieu étranger, coupés de leur langue, et souvent, pour les plus jeunes, obligés de s’insérer dans les sociétés des pays d’accueil pour survivre matériellement, ne pouvaient pas vivre en vase clos et se désintéresser de la vie littéraire européenne. À Paris, par exemple, ils suivaient la production littéraire française avec grand intérêt et en rendaient compte dans divers organes de presse. Cet intérêt pour la littérature française contemporaine devint même le signe caractéristique de l’appartenance à la « jeune génération » des écrivains de l’émigration, c’est-à-dire ceux qui étaient devenus écrivains sur le sol étranger, lesquels s’en servaient pour se démarquer des écrivains de l’« ancienne génération » qui n’étaient à leurs yeux que de stériles conservateurs, contempteurs du modernisme européen.
Les recensions d’uvres françaises contemporaines sont nombreuses dans les diverses revues et quotidiens de l’émigration et prouvent un véritable intérêt pour la littérature française, même si, d’autre part, les nombreux mémoires écrits par les acteurs de la vie littéraire émigrée de l’entre-deux-guerres ne cessent de souligner l’absence de véritables contacts entre les deux communautés (ce que Leonid Livak relativise dans plusieurs de ses publications1).
L’arrivée à Paris des premiers écrivains de l’émigration russe coïncide avec la reconnaissance du talent de Marcel Proust et la naissance de sa gloire. Bien que Du côté de chez Swann ait été publié avant la guerre, en 1913, et l’on connaît bien l’histoire difficile de cette première publication, le talent de Proust n’est véritablement reconnu que dans les années 1920, après l’attribution du prix Goncourt, en 1919, à son roman À l’ombre des jeunes filles en fleurs, et la violente polémique qui s’ensuivit. L’émigration n’a pas manqué de réagir à cet événement et Proust est sans doute l’écrivain français le plus souvent mentionné dans ses écrits. On lui consacre plusieurs articles, on le convoque dans de très nombreuses recensions d’uvres littéraires, on décèle son influence, on affirme son génie. Il figure pour beaucoup la réussite éclatante de la littérature française, son talent novateur, l’étalon d’excellence auquel se trouve mesuré tout écrivain contemporain. Proust n’était alors pas encore traduit en russe, la première traduction, en URSS, date de 1927 et fut d’ailleurs saluée, dès sa parution, dans Zveno (Le Chaînon)2. L’émigration se trouvait donc dans une position privilégiée, à Paris, pour suivre la publication des romans proustiens et en rendre compte.
Il est impossible de dresser ici un tableau complet de la réception de Proust par les écrivains émigrés, c’est pourquoi je ne m’arrêterai que sur trois points : d’abord, sur les articles critiques qui lui ont été entièrement consacrés, j’en ai relevé six, publiés entre 1921 et 19283 ; ensuite sur la différence d’appréciation de l’héritage proustien dans les deux générations d’écrivains émigrés et, enfin, sur l’écrivain que l’on peut, en un certain sens, nommer le plus proustien des écrivains émigrés, Jurij Fel’zen.
L’émigration n’a rien dit d’original sur Proust et l’on sent même distinctement que les divers critiques émigrés avaient soigneusement lu les articles de leurs confrères français, ne serait-ce que ceux de la prestigieuse Nouvelle Revue Française ; ils ont toutefois très tôt reconnu son talent. Plusieurs critiques se sont attachés à introduire son uvre auprès du public russe, et ce dès 1921, c’est-à-dire dès les débuts de la presse émigrée. Proust est, certes, déjà célèbre, il a reçu le prix Goncourt, suscité la polémique, mais les événements russes l’avaient occulté. Il convient donc de souligner que l’émigration a très tôt accordé à Proust la place qui lui revenait dans la production littéraire française des années 1920.
Le premier article qui lui est entièrement consacré fut écrit par Boris de Schlzer qui deviendra non seulement un éminent critique musical et traducteur, mais aussi l’auteur des trois premiers articles consacrés à Proust dans la presse émigrée. Né à Vitebsk en 1881 d’une mère d’origine belge et d’un père russe, il est arrivé à Paris en 1921 et devint la même année collaborateur de la NRF. Comme il l’a lui-même rappelé à diverses reprises, il lit Proust dès son arrivée en France et lui voue aussitôt une grande admiration. Son article a pour titre « Une uvre miroir » 4, un titre qu’il critiquera en 1924, regrettant qu’il ait pu suggérer de la passivité chez Proust. Ce premier article, publié dans Sovremennye zapiski où Schlzer publiera d’autres articles sur des écrivains français, notamment sur Paul Claudel, dénote une véritable compréhension des enjeux de la création du romancier français. On sent le critique conquis par l’uvre qu’il présente à son lecteur, à tel point qu’il utilise des motifs proustiens pour en rendre compte, se servant des propres réflexions de Proust pour commenter son uvre. Il ne faut nullement y voir un défaut méthodologique, le critique ayant pour fonction de présenter au public l’uvre, d’en dégager le sens, afin de lui donner envie de la lire. La position de Schlzer sera encore celle de Benjamin Crémieux dans l’étude qu’il publiera sur Proust en 19275. Proust est d’entrée de jeu qualifié de grand écrivain français, son talent original marque le début d’une nouvelle époque, son uvre est appelée à faire de nombreux émules. Même le fait que ses romans ne font pas l’unanimité a vocation de confirmer son statut de grand écrivain.
Puis Schlzer passe au style de Proust qu’il se propose de défendre, même si, parfois, le gêne une profusion de détails qui lui semblent manquer de hiérarchisation. Après une description classique de la phrase proustienne, « de longues phrases, parfois d’une demi-page, à la construction extraordinairement complexe, pourvues de nombreuses propositions subordonnées, d’incidentes, qui, souvent, en comprennent elles-mêmes d’autres, parfaitement indépendantes et placées entre parenthèses » 6, phrase à laquelle il dénie toute musicalité, jusqu’à voir dans cette caractéristique l’originalité de Proust dans la littérature française contemporaine, laquelle mettrait en pratique l’injonction de Verlaine « De la musique avant toute chose » 7, Schlzer passe à la vision de l’écrivain. Il a en effet bien compris que la phrase proustienne est tributaire du mode de pensée de son auteur, qu’elle épouse exactement les sinuosités de sa pensée qu’elle traduit syntaxiquement. Il est même frappant de voir à quel point le commentaire de Schlzer, dès 1921, anticipe celui de Jean Milly : « [La phrase longue] est le versant signifiant d’une pensée complexe, qu’il importe de ne pas fragmenter ni briser. » 8 Schlzer en arrive ainsi au motif du nouvel écrivain, tel que Proust l’introduit à propos de la déception qu’éprouve le narrateur, à un certain moment, pour l’uvre de Bergotte. Le nouvel écrivain, selon Proust, est celui qui donne à voir au lecteur un nouveau monde, celui qui crée ainsi un monde nouveau. Schlzer, qui seul parmi les auteurs d’articles dont il est ici question illustre ses dires avec des extraits des romans proustiens qu’il traduit lui-même, cite ce passage tiré du Côté de Guermantes :
Pour réussir à être ainsi reconnus, le peintre original, l’artiste original procèdent à la façon des oculistes. Le traitement par leur peinture, par leur prose, n’est pas toujours agréable. Quand il est terminé le praticien nous dit : « Maintenant regardez. » Et voici que le monde (qui n’a pas été créé une fois, mais aussi souvent qu’un artiste original est survenu) nous apparaît entièrement différent de l’ancien, mais parfaitement clair. [...] Tel est l’univers nouveau et périssable qui vient d’être créé. Il durera jusqu’à la prochaine catastrophe géologique que déchaîneront un nouveau peintre ou un nouvel écrivain originaux.9
Car comme le sait tout lecteur du Temps retrouvé, ce que ne pouvait être Schlzer en 1921, le style n’est pas affaire de technique, mais de vision10, ce que s’applique précisément à montrer le critique russe. Et c’est parce que Proust dispose d’une vision hypertrophiée qu’il est capable d’analyser aussi minutieusement les détails d’une sensation, d’un caractère ou d’un phénomène. Il ne recherche nullement l’originalité à tout prix ni l’hermétisme, il nous montre simplement le monde tel qu’il le voit. Si le lecteur a l’impression de descriptions trop détaillées, c’est que Proust, ou son narrateur11, adopte simultanément plusieurs points de vue : la description ne dépend pas d’un point de vue unique qui, précisément, hiérarchiserait les objets décrits, elle traite, au contraire, de ce qui peut, au premier abord, paraître accessoire à côté du principal. Pour illustrer cette explication, Schlzer cite le passage consacré à l’attaque de la grand-mère, coupé par la description d’un mur12.
À la fin de cet article, le critique revient sur les prédécesseurs qu’il trouve, à la suite de ses confrères parisiens, à Proust dans la littérature française, lesquels sont Stendhal13 et Montaigne14. Il est à noter que Schlzer ne renoncera pas à ces rapprochements dans le deuxième article qu’il consacrera à Proust après la mort de ce dernier, et qui sera publié au début de 192315. À son avis, Proust est allé plus loin que Stendhal dans l’analyse des sentiments tout en cultivant le rôle d’observateur qui fut celui de Montaigne. Ce que nous pouvons retenir, c’est que Proust, pour le critique russe, appartient entièrement et complètement à la tradition littéraire française et qu’il ne lui voit aucun point commun avec quelque écrivain russe que ce soit. Cela est même souligné dans l’article de 1923, dans lequel Schlzer se moque de l’erreur grossière qui consiste à comparer Proust et Dostoevskij. Il n’est d’ailleurs pas le seul à mentionner Dostoevskij en parlant de Proust, afin, sans doute, de corriger les formulations de certains critiques français. Pour Schlzer, Proust n’a rien à voir avec la littérature russe. Ses personnages par exemple, explique-t-il, restent cartésiens, leur fonctionnement est toujours logique, ce que l’on ne peut dire des personnages dostoïevskiens. Dans ce deuxième article, Schlzer n’ajoute rien de significatif à son commentaire de 1921, mais cite Paul Desjardins, André Gide et Jacques Rivière. Il montre ainsi qu’il lisait avec attention la presse littéraire française, ce qui n’est guère étonnant pour ce collaborateur de la NRF qui aura, dès décembre 1923, une rubrique mensuelle sur les nouveautés littéraires occidentales dans Zveno16. Il a, comme d’autres, lu attentivement le numéro que la NRF a publié en hommage à Proust en janvier 1923. Schlzer consacrera enfin une recension à La Prisonnière, en 192417, dans laquelle il répètera son admiration pour Proust, l’égal de Flaubert et de Balzac. Même si l’on sent parfois que Proust n’a pas eu le temps de relire attentivement son uvre, ce tome ne le cède en rien aux précédents. En passant, Schlzer récuse le reproche d’immoralité que l’on adresse communément à Proust puisque le thème homosexuel n’est qu’un matériau pour cet écrivain qui se comporte plus en logicien qu’en psychologue, si bien que ce long roman est aux yeux du critique russe le plus impersonnel de la littérature, malgré le récit conduit à la première personne. Il termine sa recension sur l’impression de désespoir, de sombre pessimisme qui se dégage du roman, lequel illustre une nouvelle fois le leurre que représente tout sentiment amoureux. On peut donc noter que le premier critique à consacrer trois articles à Proust dans la presse de l’émigration, dès 1921, est un critique averti, qui apprécie l’uvre du romancier français. Il cherche honnêtement à donner envie de la lire au lecteur émigré, en lui expliquant, à l’aide de passages tirés de La Recherche, qu’il ne doit pas être rebuté par la nouveauté de l’écriture proustienne, gage, au contraire, de la valeur de cet écrivain.
Le deuxième auteur émigré qui a écrit un article entièrement consacré à Marcel Proust est Mark Aldanov, auteur prolifique et apprécié de romans et portraits historiques. Son article a été publié dans Sovremennye zapiski, où étaient éditées ses propres uvres, en 192418. La date a son importance puisque dans une lettre adressée à Vera Bunina, Aldanov tire indûment fierté d’avoir, le premier, attiré l’attention du public émigré sur l’uvre de Proust19. Les articles déjà cités de Schlzer prouvent son erreur et ce, d’autant plus que l’article d’Aldanov, sous couvert de compliments, critique en fait sévèrement Proust. Il s’agit d’un article polémique qui feint de ne pas l’être. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Aldanov n’est pas un fervent admirateur de Proust, même s’il se sent obligé de sacrifier à son culte. Il déclare, dans cet article, ne pas avoir l’intention d’écrire une recension en bonne et due forme, il veut simplement faire partager au public l’impression qui fut la sienne à la lecture des romans proustiens, lecture faite après la mort de leur auteur, parce qu’elle lui semble largement la plus juste.
Aldanov s’est servi toute sa vie d’une même formule pour juger une uvre littéraire : « action, caractères, style » . Or, chez Proust, il n’y a aucune action et le style lui déplaît. Il a trouvé cette lecture spécialement difficile et ne peut imaginer que l’écrivain n’a pas sciemment recherché l’hermétisme : « Tout fatigue dans les livres de Proust, tout jusqu’à la typographie. Tout ou presque irrite également, jusqu’à la dédicace à Léon Daudet. »20 La seule chose qu’il apprécie, ce sont donc les caractères, les personnages de Proust qu’il trouve, à la différence de Schlzer, vivants, presque aussi vivants que ceux de Lev Tolstoj, ce qui n’est pas un mince compliment sous sa plume : il n’y avait pas, pour Aldanov, de plus grand écrivain que Tolstoj. Les romans de Proust sont aussi les plus méchants qu’il ait jamais lus, d’où cette remarque qu’on ne peut lire les fréquents témoignages sur la bonté de Proust sans sourire. Ce trait rapproche également le romancier français de Tolstoj, dont Aldanov a toujours dit qu’il n’y avait jamais eu plus grand misanthrope21. Le jugement est somme toute assez sévère et ce qui trouve grâce à ses yeux semble directement imputable à l’influence de Tolstoj. L’idée que Proust doit beaucoup à Tolstoj est d’ailleurs l’idée majeure de l’article, même si elle n’y apparaît qu’à la fin. Aldanov n’y renoncera jamais, si bien qu’on la retrouvera tant dans sa réponse à l’enquête de la revue Čisla (Nombres), en 1930, que dans un projet de préface pour une anthologie américaine d’uvres russes, pendant la guerre. Aldanov n’est, d’ailleurs, pas le seul à avoir fait ce rapprochement entre Proust et Tolstoj, nous le trouvons également dans la réponse d’Ivan melev à la même enquête de la revue Čisla, puis dans les leçons consacrées par Vladimir Nabokov au roman Du côté de chez Swann. Au demeurant, qui mieux qu’un écrivain émigré pouvait le noter dans les années 1920 ?
Pour autant, il est évident que ce qui intéresse Aldanov chez Proust au premier chef, c’est non le moi profond, l’uvre, mais le moi social. Il agit à la façon d’un Sainte-Beuve pour lequel compte avant tout le mondain devenu célèbre par ses excentricités, d’où la place accordée dans son article aux poncifs, de la chambre tapissée de liège aux sorties nocturnes. Si bien que le lecteur ne peut que s’étonner devant la phrase suivante, à laquelle rien ne l’a préparé :
Mais on ne peut s’arracher à ces livres. Après avoir lu le premier d’entre eux, je compris clairement qu’une nouvelle page venait de s’ouvrir dans la littérature mondiale et qu’en cette nuit, sur la place du Trocadéro, j’avais manqué l’occasion de voir le plus grand écrivain du xxe siècle.22
Nous rappelons que l’article date de 1924, on ne peut donc nier la clairvoyance de son auteur. Mais on peut aussi évoquer le passage des mémoires de Vasilij Janovskij, Champs Élysées (Polja Elisejskie), où ce dernier qui, il est vrai, ne porte pas dans son cur Aldanov, représentant d’une « ancienne génération » à ses yeux complètement fermée à la littérature moderne, écrit :
Aldanov comprenait qu’il fallait louer Proust, mais je crois qu’il ne l’avait pas lu. Alors qu’il parlait de lui en termes élogieux, il pouvait citer le nom d’un autre écrivain qu’il était impossible de comparer à Proust, par exemple Marquand. Et d’ailleurs, l’on ne saurait relever la moindre trace laissée par Proust chez Mark Aleksandrovič. Cependant il répétait souvent qu’il ne pouvait se pardonner deux erreurs fatales : ne pas être allé à Jasnaja Poljana et ne pas avoir vu Proust en chair et en os, alors qu’il l’aurait pu. C’est caractéristique d’Aldanov : lire Proust n’était pas obligatoire, mais l’observer du coin d’un café l’était.23
Loin de nous l’idée de vouloir reprocher à Aldanov de ne pas avoir su apprécier Proust à sa juste valeur, ce serait absurde. Ce qu’il importe de montrer, c’est le caractère obligé de ses maigres louanges et qu’il ne se sent pas le droit de proclamer sans ambiguïté que Proust est illisible, de peur d’être jugé écrivain dépassé. Il suit le diktat de la mode à contrecur, si bien que son article n’ajoute rien à ceux de Schlzer. Les quelques mentions de Proust faites par la suite auront au moins le mérite d’être plus claires, moins hypocrites. Le succès de La Recherche est, pour Aldanov, comparable à celui de Que faire ?, ce n’est qu’un effet de mode :
Marcel Proust a agi de façon très risquée en basant tout son avenir sur un seul des membres de la triade : il n’y a en effet chez lui aucune action, quant au style de Proust, seuls les originaux peuvent l’apprécier. Les conséquences de ce choix se font d’ailleurs déjà sentir : ce génial écrivain est déjà entamé par le temps, bien qu’il y ait à peine dix ans qu’il a disparu.24
Le quatrième article consacré à Proust est celui de Konstantin Močul’skij, écrit à l’occasion de la publication d’Albertine disparue et édité dans Zveno25, revue littéraire où Močul’skij publiait de nombreux articles consacrés à la littérature occidentale. C’est d’ailleurs lui qui avait succédé à Schlzer à la tête de la rubrique : « Les nouveautés de la littérature française » . Il réaffirme avec éclat le talent de Proust et renonçant à lui trouver des prédécesseurs ou des pairs, souligne son originalité. C’est dans ses romans, écrit-il, que passe la ligne de partage entre littérature ancienne et nouvelle. Il ajoute quelques réflexions sur la construction soignée du roman, jusqu’alors mise en doute, mais qui commence à se découvrir précisément dans ce volume dont le seul héros est le temps. Močul’skij rend donc compte d’une façon très élogieuse de la publication de l’avant-dernier tome de La Recherche, dont un extrait paraîtra en traduction russe, dans Volja Rossii (La Volonté de la Russie) en 1929. Les critiques russes suivent donc avec attention, comme leurs collègues français, la publication posthume des derniers tomes de l’épopée proustienne.
Enfin, en 1928, paraît, encore une fois, dans Zveno, une revue dont la rédaction avait à cur de faire connaître à ses lecteurs la littérature européenne ainsi que de lui en proposer des traductions, un article signé K. enin26 suite à la publication du Temps retrouvé qui, plus de cinq ans après la mort de Proust, clôt enfin la série de ses romans. Cet article rend justice à la composition du roman, maintenant que le lecteur peut en apprécier toute la rigueur « mathématique » , et réaffirme la prééminence de Proust sur les lettres françaises de l’époque. enin y affirme une nouvelle fois le caractère novateur de la poétique proustienne et cherche à en convaincre le lecteur émigré. La biographie de l’écrivain ne l’intéresse pas27, seule compte son uvre promise à une longue postérité : « La biographie de Proust commence le jour de la publication de Du côté de chez Swann ; il est né à la minute où a mûri en lui l’idée du temps perdu et retrouvé »28, car Proust s’est totalement sacrifié à son uvre, la seule réalité qui comptât pour lui.
On sent que enin a été sensible aux développements théoriques que Proust a placés dans Le Temps retrouvé et qu’il en a compris toute l’importance. Ainsi souligne-t-il que la recherche du temps perdu n’est pas une fuite dans le passé, mais la recherche de l’éternité, ou comme l’écrira plus tard Gérard Genette, la recherche du « temps à l’état pur, c’est-à-dire, en fait, par la fusion d’un instant présent et d’un instant passé, le contraire du temps qui passe, l’éternité »29. La révélation finale permet donc au narrateur d’arrêter le temps. enin voit enfin la révolution proustienne dans l’émergence d’un réalisme spirituel. Toutes les analyses minutieuses de Proust, écrivain spiritualiste, ont pour but d’isoler des parcelles d’esprit. Il fonde cette formulation sur les passages bien connus du dernier tome, dans lesquels le narrateur qui vient de vivre la révélation finale comprend enfin qu’il dispose des moyens nécessaires pour faire uvre d’art : « [...] il fallait tâcher d’interpréter les sensations comme les signes d’autant de lois et d’idées, en essayant de penser, c’est-à-dire de faire sortir de la pénombre ce que j’avais senti, de le convertir en un équivalent spirituel. »30 C’est pourquoi, conclut enin, le but de l’art qui est, chez Proust, la vérité se trouve dans l’esprit. Il ajoute enfin que le spiritualisme n’a pas seulement déterminé la forme du roman proustien mais aussi son contenu psychologique, déterminant les affres du narrateur ainsi que sa philosophie de l’amour.
Cet article est une présentation sensible du Temps retrouvé, dont la publication permet désormais à chaque lecteur de comprendre non seulement la composition des romans de Proust, mais aussi l’esthétique qui les sous-tend. Le lecteur émigré a donc en main tous les outils, ou presque, pour lire Proust.
Ces différents articles démontrent que les hommes de lettres de l’émigration ne sont pas passés à côté de Proust et ont rapidement reconnu son talent. Les articles qui lui sont entièrement consacrés sont, certes, relativement peu nombreux et jamais du niveau de ceux d’un Ernst Curtius, mais personne ne met en doute son importance. Georgij Adamovič n’a jamais consacré d’article à Proust, pourtant il écrit, en 1924, dans un article qui traite du nouvel âge d’or du roman français : « Proust est totalement invulnérable. Seule la composition de ses romans est discutable. Mais chacune de ses pages prise en particulier est proprement merveilleuse.»31 Alors que les tirages des romans de Proust et le nombre d’articles qui lui étaient consacrés diminuaient en France dans les années 1930, l’émigration continuait à le lire et à le commenter, grâce notamment à la ferveur de certains représentants de la jeune génération, qui obtinrent une tribune privilégiée dans la revue Čisla.
Avec le premier numéro de cette revue, édité à Paris en 1930, le nom de Proust réapparaît avec force dans la presse émigrée. Dans la note préliminaire de la rédaction, qui ouvre le volume, les auteurs affirment que leur statut d’émigré leur permet de comprendre de l’intérieur la culture occidentale. Ils se voient comme un pont entre la Russie et l’Occident, veulent aider la première à mieux comprendre l’Occident et vice versa. Ils illustrent ce propos d’un seul exemple, précisément celui de Proust :
Nous avons vu et voyons comme de l’intérieur les événements contemporains les plus importants de la vie occidentale, par exemple, pour ne parler que de littérature, le développement de l’influence de Proust, la confirmation de son génie.32
Leur exil est une expérience capitale qui permet une symbiose avec la culture européenne, ce qui n’avait encore jamais eu lieu à une telle échelle.
Et comme ce premier numéro se termine par une enquête sur Proust, à laquelle ont répondu sept écrivains, il n’est pas exagéré de dire qu’il s’ouvre et se referme sur Proust dont le génie est affirmé avec éclat. Je dois toutefois ajouter que Čisla ne contient pas d’articles spécialement consacrés à Proust, et que si le romancier français y est très souvent cité, il ne fait l’objet d’aucune étude particulière. Seul un article de Fel’zen mentionne Proust dans son titre, il s’agit de l’article « Proust et Joyce » , paru dans le sixième numéro, en 193233. C’est une défense de Proust que Fel’zen s’offusque de voir placer sur le même plan que James Joyce. Il est en effet persuadé que Proust est meilleur romancier que Joyce et ce, parce qu’il a su ordonné le chaos de ses impressions. Cet article est une réponse directe à celui de Boris Poplavskij, publié l’année précédente sous le titre : « À propos de Joyce » , et dans lequel le jeune poète louait précisément Joyce pour respecter, au contraire de Proust, le chaos de la vie intérieure dans les monologues de ses personnages, il concluait ainsi :
Il semble parfois qu’il y a entre Joyce et Proust la même différence qu’entre la douleur d’une brûlure et le récit de cette douleur.34
Mais revenons à l’enquête sur Proust qui clôt le premier numéro en 1930. Elle comportait trois questions :
Estimez-vous que Proust est l’un des plus grands interprètes de notre époque ? Reconnaissez-vous dans la vie contemporaine les héros et l’atmosphère de son épopée ? Pensez-vous que les singularités du monde proustien, sa méthode d’observation, son expérience spirituelle et son style vont exercer une influence déterminante sur la littérature mondiale du proche avenir, et plus particulièrement sur la russe ?35
Les sept réponses reçues par la revue sont classées selon l’ordre alphabétique du nom de leurs auteurs36. La première réponse est ainsi celle d’Aldanov qui répète que Proust est un grand écrivain, un grand psychologue qui doit énormément à Lev Tolstoj, mais qu’il reste parfaitement étranger à la littérature russe, ce qui est une conclusion quelque peu paradoxale si l’on estime que le romancier français n’est qu’un simple épigone de Tolstoj. Quatre autres écrivains russes ont répondu à ces questions. Ils n’appartiennent ni au groupe des auteurs publiés dans Čisla, ni même à la « jeune génération » , en effet si Nabokov y appartient de facto par l’âge, il est trop fermement opposé à sa philosophie pour qu’on puisse l’y inclure sans réserve. Cela est d’ailleurs manifeste dans sa réponse, laquelle se contente de critiquer la formulation des questions, récusant, par exemple, le rapport d’un auteur à son époque et refusant de parler d’influence. Lui qui apprécie Proust et à propos duquel un témoignage nous apprend qu’il avait déjà lu deux fois La Recherche à cette époque37 ne loue pas spécialement le romancier français. Il se contente de rappeler que Proust est grand quand il touche à l’universel. Nabokov est pourtant l’un des écrivains émigrés qui connaissait le mieux l’uvre de Proust, comme le montrera, en 1937, son roman Le Don, dont la structure, par exemple, rappelle assez exactement celle de La Recherche. L’histoire de Fedor Godunov-Čerdyncev est aussi celle d’une vocation, l’histoire de la naissance d’un écrivain. Les rapports de Nabokov et Proust sont connus, ils ont fait l’objet de plusieurs études, je ne vais donc pas m’y arrêter.
Les réponses à cette enquête sont fort diverses et vont de l’éloge à l’éreintement, en passant par le jugement ambivalent d’un Georgij Ivanov. Si Mihail Cetlin affirme que Proust est l’un des plus grands écrivains de l’époque et regrette qu’il n’exerce aucune influence sur les auteurs russes, melev se moque dédaigneusement de la mode de Proust et déclare qu’un écrivain aussi mondain ne saurait satisfaire un esprit russe. Il invite même à lui préférer un obscur écrivain du xixe siècle, Mihail Al’bov (1851-1911), prétendant qu’on trouve chez celui-ci tout ce qui fait la gloire de Proust, de longues phrases alambiquées, des descriptions minutieuses. L’émigration a longtemps fait des gorges chaudes de cette réponse outrancière. On a voulu y voir l’exemple du passéisme des représentants de l’« ancienne génération » , complètement fermés aux nouvelles tendances de la prose européenne, et partant, se contentant de créer comme ils le faisaient avant le cataclysme de la révolution, figeant la tradition russe dans un immobilisme qui lui serait fatal. De fait, l’on remarque une nette différence dans l’appréciation de l’uvre de Proust, suivant que l’on appartienne à la « jeune » ou à l’« ancienne » génération. L’une des raisons en est, peut-être, la maîtrise de la langue française. Il est en effet notoire que melev ne parlait pas très bien français, au contraire d’écrivains tels que Nabokov ou Fel’zen ; or, il n’est pas exagéré de croire qu’une bonne connaissance du français est nécessaire pour apprécier le style de Proust. Mais la raison principale en est, plus vraisemblablement, le besoin de s’affirmer chez les représentants de la « jeune génération » , dont le statut d’écrivain était constamment remis en cause par leurs aînés. Proust leur servait à se démarquer tant de leurs « pères » que de leurs confrères soviétiques. Ils s’affirmaient ainsi comme écrivains modernes, très au fait des enjeux d’une création littéraire soucieuse de traduire son époque. C’est pourquoi, ils n’ont pas récusé la comparaison qu’on faisait de leurs uvres avec celles de Proust, sans que cela ne signifie toujours qu’ils la trouvaient pertinente, voire qu’elle leur plaisait.
C’est une classique querelle des pères et des fils, ou une querelle des Anciens et des Modernes, qui s’est rejouée en émigration. Les pères ne se reconnaissant pas dans leurs fils, il leur fallait y trouver une raison qui ne remettrait en cause ni leur vocation, ni leur poétique. Ils la trouvèrent dans la soi-disant influence de Proust, un moyen commode de stigmatiser la non-russité des fils, en danger de dénationalisation, préférant la littérature européenne contemporaine, et particulièrement française, à la tradition russe que l’émigration avait pourtant vocation de préserver et de sauver. Proust dont le nom était alors dans toutes les bouches, dont les romans faisaient couler beaucoup d’encre, cristallisa sur son nom cette opposition classique de deux générations, laquelle avait, en outre, été souvent utilisée par la critique russe depuis près d’un siècle. Si bien que, paradoxalement, ce sont les pères qui décelèrent l’influence de Proust dans les uvres des fils, alors même que ceux-ci la revendiquaient rarement. Très nombreuses en effet sont les recensions qui constatent une influence de Proust sur les jeunes écrivains. Mihail Osorgin, Vladislav Hodasevič, Georgij Ivanov, Vladimir Vejdle, Georgij Adamovič, Petr Bicilli, Mihail Kantor, Mark Slonim, Mihail Cetlin, Petr Pil’skij, Al. Novik, Georgij Hohlov, Jurij Terapiano et sans doute beaucoup d’autres ont tous décelé cette influence dans les uvres qu’ils ont recensées38. Beaucoup s’en servirent comme d’une critique cryptée, plus ou moins sévère : ressembler à un écrivain français n’était pas l’idéal vers lequel devait tendre un écrivain russe exilé. À lire ces recensions, il semble bien que la plupart de leurs auteurs avait tranché et trouvé une réponse univoque à la question que Osorgin dans le premier numéro de Novaja gazeta (La Nouvelle gazette) en mars 1931 : « Quelle attitude adopter à l’égard des émules de Proust et de Joyce, devons-nous les craindre ou les encourager ? »39 Il s’est agi le plus souvent de les remettre dans le droit chemin, même si certains, tels Aleksej Remizov ou Vladislav Hodasevič, n’étaient pas alarmistes : pour le premier c’était une chance pour les jeunes écrivains de lire sur place et dans l’original la nouvelle littérature française, pour le second Proust était un maître comme un autre40.
Il convient de noter que le simple recours à la mémoire, aux souvenirs, une construction circulaire, ou une phrase à la syntaxe non traditionnelle suffisait à faire de son auteur un épigone de Proust. Je n’affirmerais pas qu’Une soirée chez Claire (Večer u Kler) ne doit rien à Proust, pourtant force est de constater que Osorgin, qui le premier prononça le nom de Proust à propos de ce roman de Gajto Gazdanov, aurait bien été en peine de montrer en détail en quoi se reflétait l’influence de Proust. La situation du héros, lequel se remémore sa vie antérieure, allongé aux côtés de la femme dont il a été amoureux plus de dix ans et qui vient de devenir sa maîtresse, précipitant ainsi la fin de son amour, suffit à lui rappeler spontanément le premier tome de La Recherche, sans qu’il lui soit nécessaire de vérifier que le style et la composition du roman répondent à l’esthétique proustienne.
Les jeunes auteurs, pour leur part, n’ont pas réellement commenté le choix de Proust comme modèle. Au contraire, Nabokov, par exemple, a toujours refusé de s’exprimer sur les influences dont il pouvait être l’objet, quant à Gazdanov, il assurait qu’il n’avait pas encore lu La Recherche à l’époque où tous le considéraient sous l’influence de Proust, ce que, par ailleurs, l’on est en droit de mettre en doute, si l’on se rappelle combien le personnage de Mademoiselle Tito dans le récit La Prison des eaux (Vodjanaja tjur’ma) peut rappeler Madame Verdurin. En revanche, ils citent souvent Proust dans leurs articles ou recensions, Fel’zen le convoque ainsi à plusieurs reprises et l’utilise comme référent idéal.
En fin de compte, Proust représente un danger pour les uns, et une justification pour les autres. Par l’intermédiaire de son nom, l’on touche aux questions de l’évolution littéraire et de la mission de la littérature. Pour les représentants de l’« ancienne génération » dont la plupart voyaient dans la personne de l’écrivain sinon un prophète du moins un maître à penser qui se doit de traiter les grandes questions que se pose le lecteur de son époque, Proust n’est qu’un esthète qui poursuit un but égoïste, cherchant à comprendre et à décrypter ses sensations. Il leur semble que nul message utile ne se dégage de son uvre. C’est un partisan de l’art pour l’art qui ne peut servir de modèle, ni donner de réponse. En revanche, pour les représentants de la jeune génération, tragiquement coupés de leur passé, il peut indiquer la voie à suivre, donner une méthode, si l’on a comme eux choisi de faire le portrait de l’émigré russe des années 1930 au moyen de l’introspection.
Proust est à leurs yeux le champion de la représentation de la vie intérieure et de la sincérité. Comme ses disciples français des années 1930, les jeunes émigrés ne peuvent se résoudre à peindre de grandes fresques, à créer de toutes pièces un monde imaginaire. Il leur manque pour cela de l’assurance. Ils sont intimement persuadés de vivre une époque de grave crise spirituelle, résultat de la guerre de 1914-1918 et des révolutions russes. L’ancien monde s’est irrémédiablement écroulé, entraînant dans sa chute toutes les anciennes certitudes, les anciennes croyances. Ils doivent donc se replier sur leur moi, leur vie intérieure et c’est pourquoi la plupart de leurs uvres ont un substrat autobiographique, dédaignent les recherches purement formelles et adoptent souvent la forme de confessions ou de journal intime. Ce sont en premier lieu ces caractéristiques de leur prose qui évoquent Proust pour leurs critiques. Nadeda Gorodeckaja lors des débats qui suivirent deux conférences sur Proust au Studio franco-russe, le 25 février 1930, lie également l’influence de Proust à la crise de l’esprit, pour reprendre une expression de Paul Valéry41 :
C’est plutôt une question que je pose - et une question bien triste. Je ne crois pas que ce soit possible, surtout pour les Russes de ma génération, c’est-à-dire pour ceux qui se sont formés intellectuellement après la révolution, sans tradition, ou bien avec les traditions, si vous voulez, mais sans l’atmosphère russe, sans la Russie. Je ne vois pas ce genre d’action directe que nous pourrions produire ; naturellement ceux qui écrivent - en écrivant ; mais pour les autres et même pour les écrivains, la seule forme possible d’action sociale et morale est la contemplation passive qui se rapproche de celle de Proust. Je vois l’influence proustienne sur beaucoup de jeunes. Ce n’est pas simplement le fait de vivre en France qui les a menés à cette attitude. On lit tout, on admire d’autres maîtres sans les suivre. Ne serait-ce pas l’époque trop active de la guerre qui nous a poussés à cette réaction de silence et de contemplation ?42
Les « jeunes écrivains » sont à la recherche d’une nouvelle voie et il leur semble avoir trouvé en Proust un guide. Autre chose est de savoir si leur lecture de Proust était pertinente. La question de la réception de Proust et de son influence est, comme on le voit, des plus complexes et contradictoires. Elle rejoint en outre la question fondamentale qui n’a cessé de tourmenter le milieu littéraire émigré : une littérature est-elle possible en exil, sur sol étranger ? La crainte de voir, faute de relève, s’éteindre la littérature de l’émigration, laquelle, rappelons-le, était même pour certains la seule véritable littérature russe, obligeait la critique à suivre de près la production des jeunes écrivains. Il fallait les protéger de nombreux dangers, les obliger à cultiver leur langue sans l’appauvrir ni la corrompre, leur inculquer une éthique. Il fallait aussi veiller jalousement à ce que leurs uvres ne deviennent pas de pâles copies de romans français, le meilleur moyen semblait donc de fustiger une trop grande proximité avec des modèles occidentaux, selon un réflexe de peur sinon légitime du moins habituel. Pour pouvoir apporter une réponse satisfaisante à cette question des rapports des écrivains émigrés à l’uvre de Proust, il faudrait encore étudier soigneusement l’uvre des « jeunes écrivains » de façon à pouvoir déterminer s’ils ont été ou non véritablement influencés par Proust. Je n’évoquerai ici que le cas de Fel’zen, et encore trop rapidement43.
C’est le plus évident de tous. Fel’zen, de son vrai nom Nikolaj Berngardovič Frejdenstejn, a en effet abondamment parlé lui-même de sa grande admiration pour Proust. Paradoxalement, il l’a fait avec le plus de conviction dans le troisième de ses romans, Lettres sur Lermontov (Pis’ma o Lermontove), dont des extraits ont été publiés dans la revue Čisla, et le texte intégral à Paris, en 1935. Il y déclare sans ambages que Proust est un véritable miracle et assigne à l’émigration la mission d’implanter Proust en Russie, de le greffer sur la littérature russe44. C’est ce que lui-même a tenté de réaliser dans ses romans. Tels ceux de Proust, ils sont organisés en une série romanesque, malheureusement restée inachevée, en raison de la mort de Fel’zen à Auschwitz en février 1943. Ces romans sont au nombre de trois, Un Leurre (Obman), publié à Paris en 1930, Le Bonheur (Sčast’e), publié à Berlin en 1932, et Lettres sur Lermontov, déjà cité. On ne sait pas dans quelle mesure Fel’zen avait une idée précise du plan et de l’ampleur de cette série , mais on sait qu’il travaillait au tome suivant Récapitulation (Povtorenie projdennogo) dans la seconde moitié des années 1930. Les trois romans ont pour seul et même héros un certain Volodja, écrivain émigré qui vit à Paris, narrateur homodiégétique qui conduit le récit de ses difficiles amours avec Lelja à la première personne. Ces rapports amoureux rappellent, parfois même très exactement, ceux des personnages de La Recherche, comme peut aisément le prouver le titre du premier roman, qui définit l’amour dans la plus pure tradition proustienne. Pourtant, Volodja ne peut se passer de Lelja, du moins dans les trois premiers tomes, puisque, sans elle, il ne peut écrire, elle est sa muse. L’influence proustienne se fait sentir tant au niveau thématique qu’au niveau stylistique. Il semble qu’aux yeux de Fel’zen, Proust ait été avant tout le peintre désenchanté des rapports amoureux, l’écrivain de la jalousie et non celui du temps. Le thème de l’amour, des rapports entre l’homme et la femme, est donc prépondérant, comme il l’est également chez les écrivains qu’apprécie Fel’zen, en particulier Jacques Chardonne. À cela s’ajoute le thème de l’écriture, de la création littéraire, ce qui peut nous induire à considérer les romans de Fel’zen comme des métaromans explorant le thème de la création littéraire en exil. Il se pourrait très bien que Fel’zen ait songé à raconter l’histoire de la vocation de Volodja, même si ce dernier, contrairement au narrateur de La Recherche, est dès le début sûr de son don, pense avoir les moyens de son uvre, dont il connaît en outre parfaitement le thème, et a la possibilité de s’adonner à son art. Il n’arrive toutefois pas à réaliser pleinement sa vocation. Ne publiant pas ce qu’il écrit, il n’est, faute de lecteur, qu’un écrivain en puissance, un écrivain non reconnu. Il n’est pas interdit d’y voir une métaphore de la difficile condition de l’écrivain exilé.
Le projet littéraire de Volodja est très proche de celui de son créateur, même si, bien évidemment, on doit distinguer le personnage de Volodja de Fel’zen lui-même. Il n’écrit que sur son vécu, ses expériences, ses propres sentiments sans jamais recourir à l’imagination. Son but est de comprendre, d’expliciter jusque dans les moindres détails ses sentiments. Naturellement tout est toujours focalisé de son point de vue et en cela la narration de Fel’zen réalise certaines des caractéristiques du roman proustien, relevées par la critique émigrée : Proust ne décrivait pas tant le monde que le point de vue d’une conscience individuelle sur ce monde. Certains lui reprochaient ainsi son parti pris solipsiste45. Il est donc manifeste, même ainsi résumé à grands traits, que le projet littéraire de Fel’zen rejoint celui de Proust. C’est pourquoi extrêmement rares sont les critiques qui ne mentionnent pas le romancier français dans leurs recensions des uvres de Fel’zen. Je n’en connais pour ma part qu’une seule46. Ils étaient en outre confortés dans leur sentiment par la longueur inhabituelle de ses phrases et de ses paragraphes.
Pourtant Fel’zen n’est en rien un imitateur servile de Proust et surtout, il n’a pas la même vision que ce dernier. Pour Fel’zen, par exemple, le monde extérieur n’existe pas, seul compte le monde intérieur du narrateur. Son style est dépourvu de toute métaphore, enfin la recherche si méticuleuse du mot juste ne le conduit pas à des comparaisons. Il est donc impossible de déceler une véritable influence au niveau stylistique, si ce n’est au niveau superficiel de la longueur des phrases. Mais, comme l’avait bien noté Schlzer, la longueur des phrases de Proust est directement tributaire de sa pensée, des méandres de sa réflexion ; le narrateur de Fel’zen réfléchit autrement.
Le cas de Fel’zen est donc exemplaire. Bien que son écrivain préféré ait été Mihail Lermontov, il a vu en Proust, lu en France, en exil, un maître qui avait déjà trouvé des réponses aux questions que lui-même se posait. Il est dès lors normal qu’il se soit intéressé à son uvre, et même qu’il l’ait lu avec admiration. Comme l’a dit Julia Sazonova, lors de la deuxième réunion du Studio franco-russe consacrée à l’influence mutuelle des littératures russe et française :
Qu’est-ce, au fond, que l’influence littéraire ? C’est la rencontre de deux esprits : l’un est inconscient de ses propres tendances et l’autre a déjà trouvé une expression nette des mêmes aspirations. [...] C’est en cela que consiste l’influence. L’un ne prend à l’autre que ce dont il a besoin. Toute autre chose est l’imitation.47
Fel’zen a donc rencontré Proust et cette rencontre fut féconde, elle orienta son projet littéraire, tout au moins le confirma.
Si influence de Proust il y a eu sur la jeune génération, au sens que je viens d’indiquer, elle semble avoir été féconde bien que transitoire, libérant les jeunes écrivains exilés d’une tutelle qui leur était pénible, leur donnant les moyens d’entrer de plain-pied dans la vie littéraire. Et même sans parler d’influence, on peut dire que l’émigration a lu Proust, l’a compris à sa façon et a tiré des leçons de cette lecture qui forcément ne pouvait plaire à tous, mais dont beaucoup sentaient la nouveauté radicale et l’importance. À l’heure où Dostoevskij hantait les esprits français, ceux des émigrés étaient tournés vers Proust, la France et la Russie s’enrichissaient mutuellement.
Notes


